DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre A
(Huitième partie)
AIDE OU ASSISTANCE
Cf. Complicité*, Délits pénaux - délits accessoires* - Non assistance à personne en péril*.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.)
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.)
- Sur l'aide et assistance fournie à l'auteur de l'infraction : n° I-249, p.265 /
n° II-116 1°, p.307 / n°
II-118 5°, p.312
- Sur l'aide assistance proposée à un mineur délinquant : n°
III-15, p.378
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-312, p.193
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-312, p.193
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-121,
p.80 / notamment
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-121,
p.80 / notamment
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents », n° 211, p.92 / n° 215, p.99 / n° 303, p.124 / n°
341, p.222 / n° 344, p.227 / n° 508, p.329 / n°509, p.333 / n°
506 p.343
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents », n° 211, p.92 / n° 215, p.99 / n° 303, p.124 / n°
341, p.222 / n° 344, p.227 / n° 508, p.329 / n°509, p.333 / n°
506 p.343
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Société », n° 22 p.23 / n° II-II-229, p.518 (et les
références de la table
alphabétique)
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Société », n° 22 p.23 / n° II-II-229, p.518 (et les
références de la table
alphabétique)
![]() Voir :
Un cours de vol.
Voir :
Un cours de vol.
- Notion. Par
l’expression « aide ou assistance » il faut entendre tout acte positif de participation à l’infraction, antérieur ou concomitant au fait principal,
mais accessoire à celui-ci
Mais il existe par ailleurs un devoir d'aide et assistance,
principalement dans le milieu familial.
![]() Digeste de Justinien, 47, II, 51, 2 et 3. Ulpien : Pédius
dit à juste titre que, de même que personne ne commet un vol sans fraude, de même on ne peut sans fraude y donner aide ou conseil... Est considéré comme
donnant conseil celui qui persuade, excite et donne des conseils pour faire le vol. Celui-là apporte son aide, qui fournit son ministère et des facilités
pour dérober la chose.
Digeste de Justinien, 47, II, 51, 2 et 3. Ulpien : Pédius
dit à juste titre que, de même que personne ne commet un vol sans fraude, de même on ne peut sans fraude y donner aide ou conseil... Est considéré comme
donnant conseil celui qui persuade, excite et donne des conseils pour faire le vol. Celui-là apporte son aide, qui fournit son ministère et des facilités
pour dérober la chose.
![]() Jousse (Traité de la justice criminelle) : La
coopération au crime peut se faire en empêchant celui qui est attaqué de se défendre, p.ex. en lui ôtant ses armes.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : La
coopération au crime peut se faire en empêchant celui qui est attaqué de se défendre, p.ex. en lui ôtant ses armes.
![]() Le Poittevin (Dictionnaire des parquets) : La
complicité par aide et assistance n’existe autant : 1° que les faits qui la constituent sont antérieurs ou concomitants à l’infraction ; 2° que
l’aide ou assistance a été prêtée avec connaissance ; 3° qu’elle s’est manifestée par un acte positif et non par une simple inaction ou
abstention.
Le Poittevin (Dictionnaire des parquets) : La
complicité par aide et assistance n’existe autant : 1° que les faits qui la constituent sont antérieurs ou concomitants à l’infraction ; 2° que
l’aide ou assistance a été prêtée avec connaissance ; 3° qu’elle s’est manifestée par un acte positif et non par une simple inaction ou
abstention.
![]() Robert (Droit pénal général) : L’aide et assistance
consistent en une contribution utile, fournie avant l’action délictueuse ou en même temps qu’elle ; le complice apporte, soit des biens soit une
activité.
Robert (Droit pénal général) : L’aide et assistance
consistent en une contribution utile, fournie avant l’action délictueuse ou en même temps qu’elle ; le complice apporte, soit des biens soit une
activité.
- Science criminelle. S'analysant en des actes accessoires, l'aide et l'assistance reposent sur un acte principal incriminé tel le meurtre, le vol ou l'incendie. Leur répression relève dès lors normalement de la théorie de la Complicité*. Mais le législateur y voit parfois un délit spécial (cas du délit d'instigation).
![]() Rigaux
et Trousse (Les crimes et les délits du Code pénal belge, T.I
p.576) : L'aide ou le secours porté à certains
individus, groupements, organismes ou puissances a été érigée en
infraction parce que l'activité déployée par ces individus,
groupements, organismes ou puissances constitue elle-même une
infraction ou parce qu'elle est dangereuse ou nuisible à l'État.
Rigaux
et Trousse (Les crimes et les délits du Code pénal belge, T.I
p.576) : L'aide ou le secours porté à certains
individus, groupements, organismes ou puissances a été érigée en
infraction parce que l'activité déployée par ces individus,
groupements, organismes ou puissances constitue elle-même une
infraction ou parce qu'elle est dangereuse ou nuisible à l'État.
![]() Code
pénal du Cameroun. Art. 97/98 : Est complice d'une
infraction qualifiée crime ou délit... celuyis qui aide ou
facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. La
tentative de complicité est considérée comme la complicité
elle-même. Les coauteurs et complices sont passibles de la même
peine que l'auteur principal.
Code
pénal du Cameroun. Art. 97/98 : Est complice d'une
infraction qualifiée crime ou délit... celuyis qui aide ou
facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. La
tentative de complicité est considérée comme la complicité
elle-même. Les coauteurs et complices sont passibles de la même
peine que l'auteur principal.
![]() Cour de cassation du Luxembourg 20 avril 1964 (Pas.
19, 314) : La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou
un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice.
La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser
toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque». L'ensemble des actes d'aide et d'assistance fournis à
l'auteur d'un vol commis avec violences par un co-prévenu dont la participation a notamment consisté à faire le guet peut être qualifié par les juges du
fond de participation principale à l'infraction, lorsque les juges estiment que ces actes ont été de telle nature que sans cette aide et cette assistance
l'infraction n'eût pu être commise.
Cour de cassation du Luxembourg 20 avril 1964 (Pas.
19, 314) : La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou
un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice.
La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser
toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque». L'ensemble des actes d'aide et d'assistance fournis à
l'auteur d'un vol commis avec violences par un co-prévenu dont la participation a notamment consisté à faire le guet peut être qualifié par les juges du
fond de participation principale à l'infraction, lorsque les juges estiment que ces actes ont été de telle nature que sans cette aide et cette assistance
l'infraction n'eût pu être commise.
- Droit positif. L'aide ou assistance est de manière générale réprimée par l'art. 121-7 C.pén. Sur ce plan, le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond apparaît particulièrement étendu ; même si la Cour de cassation veille à l'existence d'une motivation pertinente. Ainsi, un simple soutien moral ne suffit à caractériser l'élément matériel de la complicité.
![]() Cass.crim. 6 février 1992 (Gaz.Pal. 1992 II somm.
369) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable de complicité de publicité illicite en faveur du tabac les juges du second degré, après
avoir caractérisé le délit à la charge de l’auteur principal, exposent que la société P... M... France, dont le prévenu est le président directeur
général, est intervenue en tant que conseil lors de l’élaboration de la campagne publicitaire concernée et y a donné son accord.
Cass.crim. 6 février 1992 (Gaz.Pal. 1992 II somm.
369) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable de complicité de publicité illicite en faveur du tabac les juges du second degré, après
avoir caractérisé le délit à la charge de l’auteur principal, exposent que la société P... M... France, dont le prévenu est le président directeur
général, est intervenue en tant que conseil lors de l’élaboration de la campagne publicitaire concernée et y a donné son accord.
![]() Cass.crim. 6 décembre 1967 (Bull.crim. n° 311
p.725) : Caractérise la complicité par fourniture de moyen le fait de procurer un véhicule sachant qu’il devait servir à commettre un vol.
Cass.crim. 6 décembre 1967 (Bull.crim. n° 311
p.725) : Caractérise la complicité par fourniture de moyen le fait de procurer un véhicule sachant qu’il devait servir à commettre un vol.
![]() Cass.crim. 11 juillet 1994 (Gaz.Pal. 1994 II
Chr.crim. 702) : Constitue un acte de complicité par aide ou assistance toute intervention tendant à assurer la fuite de l’auteur principal, dès
lors que cette protection résulte d’un accord antérieur à l’infraction.
Cass.crim. 11 juillet 1994 (Gaz.Pal. 1994 II
Chr.crim. 702) : Constitue un acte de complicité par aide ou assistance toute intervention tendant à assurer la fuite de l’auteur principal, dès
lors que cette protection résulte d’un accord antérieur à l’infraction.
![]() Cass.crim. 31 janvier 2007 (Bull.crim. n° 25 p. 84)
: Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un expert-comptable coupable de complicité d'escroqueries commises par un dirigeant de
société, constate qu'il a attesté la conformité et la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper.
Cass.crim. 31 janvier 2007 (Bull.crim. n° 25 p. 84)
: Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un expert-comptable coupable de complicité d'escroqueries commises par un dirigeant de
société, constate qu'il a attesté la conformité et la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper.
![]() Cass.crim. 22 mai 1991 (Gaz.Pal. 1992 I Somm.20) :
Ne relève aucun acte d’aide et assistance constitutif de complicité, et ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour
déclarer le prévenu coupable de complicité d’escroquerie, se borne à retenir qu’il a moralement adhéré à l’utilisation d’une attestation portant son nom
et que son comportement revêt le caractère d’une coopération morale en raison de l’influence qu’il exerçait sur l’esprit de l’auteur matériel de
l’infraction.
Cass.crim. 22 mai 1991 (Gaz.Pal. 1992 I Somm.20) :
Ne relève aucun acte d’aide et assistance constitutif de complicité, et ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour
déclarer le prévenu coupable de complicité d’escroquerie, se borne à retenir qu’il a moralement adhéré à l’utilisation d’une attestation portant son nom
et que son comportement revêt le caractère d’une coopération morale en raison de l’influence qu’il exerçait sur l’esprit de l’auteur matériel de
l’infraction.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Cf. Défense (Droits de la)*, Partie civile*.
L’aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques, en principe européennes, qui sont dépourvues de ressources financières, et qui exercent une action n’apparaissant pas manifestement irrecevable ou non fondée. Elle donne droit à l’assistance d’un avocat et de tout officier public ou ministériel dont la procédure requiert le concours. Elle est régie par une loi du 10 juillet 1991.
![]() Cass.crim. 4 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II
Chr.crim. 102) : Lorsqu’une partie a obtenu l’aide juridictionnelle, elle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa
plainte avec constitution de partie civile.
Cass.crim. 4 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II
Chr.crim. 102) : Lorsqu’une partie a obtenu l’aide juridictionnelle, elle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa
plainte avec constitution de partie civile.
![]() Cass.crim.
15 janvier 2008, n° 07-96624 (Bull.crim. n° 4 p.43) :
Une partie civile, qui, pour soutenir son appel d’une ordonnance
de non-lieu, a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une
demande de désignation d’un avocat d’office, est bien fondée à
solliciter de la chambre de l’instruction le renvoi de
l’audience des débats dans l’attente qu’il soit statué sur cette
demande .
Cass.crim.
15 janvier 2008, n° 07-96624 (Bull.crim. n° 4 p.43) :
Une partie civile, qui, pour soutenir son appel d’une ordonnance
de non-lieu, a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une
demande de désignation d’un avocat d’office, est bien fondée à
solliciter de la chambre de l’instruction le renvoi de
l’audience des débats dans l’attente qu’il soit statué sur cette
demande .
![]() Cass.
2e civ. 29 mars 2001 (Gaz.Pal. 2001 J somm. 1322) :
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un
abus de confiance, ne peut obtenir une réparation de son
préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle
grave, peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont
inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant de ses
charges de famille .
Cass.
2e civ. 29 mars 2001 (Gaz.Pal. 2001 J somm. 1322) :
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un
abus de confiance, ne peut obtenir une réparation de son
préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle
grave, peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont
inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant de ses
charges de famille .
AIGREFIN
Cf. Chevalier d'industrie*, Escroc*, Filou*.
L'aigrefin est une sorte d'escroc, particulièrement rusé et vivant de ses machinations. Ce terme est employé plutôt par les écrivains que par les pénalistes.
![]() Petit Robert (Dictionnaire) : Aigrefin, homme qui vit
d'escroqueries, de procédés indélicats, chevalier d'industrie.
Petit Robert (Dictionnaire) : Aigrefin, homme qui vit
d'escroqueries, de procédés indélicats, chevalier d'industrie.
![]() Michelet (Histoire de France) : Lauzun, un
cadet de Gascogne, était un simple officier au régiment de Grammont. Il n'avait aucun mérite solide, nul talent ; on le vit dès qu'il fut dans les
hauts emplois. C'était un petit homme blondasse, vif, hardi et bien fait, de mauvaise mine, aigrefin, l'air méchant. Il était hargneux, provoquant, il
marchait sur les femmes, et son amour était l'insulte. Il leur plut fort. « Il est extraordinaire en tout, » dit Mademoiselle avec enthousiasme.
Michelet (Histoire de France) : Lauzun, un
cadet de Gascogne, était un simple officier au régiment de Grammont. Il n'avait aucun mérite solide, nul talent ; on le vit dès qu'il fut dans les
hauts emplois. C'était un petit homme blondasse, vif, hardi et bien fait, de mauvaise mine, aigrefin, l'air méchant. Il était hargneux, provoquant, il
marchait sur les femmes, et son amour était l'insulte. Il leur plut fort. « Il est extraordinaire en tout, » dit Mademoiselle avec enthousiasme.
![]() Taine (Les origines de la France contemporaine) :
Les biens nationaux ont été « donnés â vil prix », et les raisons ne manquent pas aux aigrefins pour se justifier à leurs propres yeux.
Taine (Les origines de la France contemporaine) :
Les biens nationaux ont été « donnés â vil prix », et les raisons ne manquent pas aux aigrefins pour se justifier à leurs propres yeux.
AIR
Cf. Eau*, Écologie*, Nature*.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Société », n° II-II-253 2°, p.550
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Société », n° II-II-253 2°, p.550
L’un des trois éléments classiques de la Nature* (voir ce mot). Il est protégé par les art. L.220-1 et s. du Code de l'environnement, complétés par des décrets visant notamment les émissions polluantes dans l’atmosphère (décret du 13 mai 1974).
![]() Cons. d'État 16 octobre 1991 (Gaz.Pal. 1992 II
panor.adm. 80) : Les effets de la centrale nucléaire et de ses installations annexes, notamment sur les eaux, la pollution de l'air, la faune et la
flore ont fait l'objet d'une analyse précise.
Cons. d'État 16 octobre 1991 (Gaz.Pal. 1992 II
panor.adm. 80) : Les effets de la centrale nucléaire et de ses installations annexes, notamment sur les eaux, la pollution de l'air, la faune et la
flore ont fait l'objet d'une analyse précise.
![]() Dijon 14 décembre 1995 (Gaz.Pal. 1996 II somm. 533)
: Les premiers juges ont décidé à bon droit que le fonctionnement d'une distillerie non conforme ... a généré pendant plusieurs années des nuisances
excédant les inconvénients normaux du voisinage, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que les prescriptions de l'arrêté préfectoral n'ont pas
été respectées, que les conditions de stockage des marcs non distillés étaient de nature à polluer les eaux fluviales voire la nappe phréatique et
généraient des «odeurs puissantes», que les nombreux prélèvements d'eau effectués sur les propriétés riveraines ont révélé « une pollution générale du
site, pouvant avoir des répercussions graves sur la santé des habitants », que des arbres avaient été détériorés par des jets de vapeur et par l'air
ambiant.
Dijon 14 décembre 1995 (Gaz.Pal. 1996 II somm. 533)
: Les premiers juges ont décidé à bon droit que le fonctionnement d'une distillerie non conforme ... a généré pendant plusieurs années des nuisances
excédant les inconvénients normaux du voisinage, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que les prescriptions de l'arrêté préfectoral n'ont pas
été respectées, que les conditions de stockage des marcs non distillés étaient de nature à polluer les eaux fluviales voire la nappe phréatique et
généraient des «odeurs puissantes», que les nombreux prélèvements d'eau effectués sur les propriétés riveraines ont révélé « une pollution générale du
site, pouvant avoir des répercussions graves sur la santé des habitants », que des arbres avaient été détériorés par des jets de vapeur et par l'air
ambiant.
Le fait de vicier l'air d'un lieu en sorte qu'il devient dangereux pour la santé peut donner lieu à une sanction pénale spécifique. Dans les cas graves, le juge français peut faire application des textes relatifs à l'empoisonnement.
![]() Nigeria (Code pénal de l'État du Zamfara).
Art. 361. Quiconque vicie volontairement l'atmosphère d'un
lieu en sorte qu'elle devient dangereuse pour la santé des
personnes présente ou de passage... sera puni de deux ans
d'emprisonnement au plus...
Nigeria (Code pénal de l'État du Zamfara).
Art. 361. Quiconque vicie volontairement l'atmosphère d'un
lieu en sorte qu'elle devient dangereuse pour la santé des
personnes présente ou de passage... sera puni de deux ans
d'emprisonnement au plus...
AISSELLES (Pendre sous les -) - Voir : Pendaison*.
AJOURNEMENT - Voir : Citation*.
AJOURNEMENT DU PRONONCÉ DE LA PEINE
Cf. Absolution*, Acquittement*, Condamnation*, Dispense de peine*, Individualisation*, Ivresse*, Peine*, Relaxe*, Sanction*.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-105, p.314
Voir :
Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-105, p.314
L’ajournement du prononcé de la peine est une technique d’individualisation ouverte à un tribunal répressif qui vient de constater la culpabilité du
prévenu, mais qui estime que ce dernier est en voie de reclassement (art. 132-60 et s. C.pén. + art. 747-3 C.pr.pén., ancien art. 469-3 C.pr.pén.)
L'art.132-70-1 C.pén. autorise la juridiction à ajourner le
prononcé de la peine concernant une personne physique lorsqu'il
apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations
complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle,
familiale et sociale.
![]() Stéfani, Levasseur et Bouloc (Droit pénal général) : Si
le reclassement du coupable, sans être acquis, est en voie de l’être, si le dommage causé va être réparé ou si le trouble résultant de l’infraction va
bientôt cesser, le tribunal correctionnel ou de police peut différer son jugement sur la peine pendant un délai pouvant atteindre un an, dans l’espoir de
pouvoir prononcer une dispense de peine.
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Droit pénal général) : Si
le reclassement du coupable, sans être acquis, est en voie de l’être, si le dommage causé va être réparé ou si le trouble résultant de l’infraction va
bientôt cesser, le tribunal correctionnel ou de police peut différer son jugement sur la peine pendant un délai pouvant atteindre un an, dans l’espoir de
pouvoir prononcer une dispense de peine.
![]() Besançon 14 juin 1983 (Gaz.Pal. 1983 II somm.
390) : Selon les dispositions de l’art. 469-3 C.pr.pén., l’ajournement du prononcé de la peine est possible lorsqu’il apparaît que le
reclassement du prévenu est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé, compte tenu des ressources du prévenu et que le
trouble résultant de l’infraction va cesser.
Besançon 14 juin 1983 (Gaz.Pal. 1983 II somm.
390) : Selon les dispositions de l’art. 469-3 C.pr.pén., l’ajournement du prononcé de la peine est possible lorsqu’il apparaît que le
reclassement du prévenu est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé, compte tenu des ressources du prévenu et que le
trouble résultant de l’infraction va cesser.
![]() Cass.crim. 22 mai 1986 (Gaz.Pal. 1987 I somm.
97) : La disposition de l’art. 469-3 C.pr.pén. qui prescrit la présence du prévenu devant la juridiction pour permettre l’ajournement du prononcé
de la peine est d’ordre public et la décision qui la méconnaît est entachée de nullité.
Cass.crim. 22 mai 1986 (Gaz.Pal. 1987 I somm.
97) : La disposition de l’art. 469-3 C.pr.pén. qui prescrit la présence du prévenu devant la juridiction pour permettre l’ajournement du prononcé
de la peine est d’ordre public et la décision qui la méconnaît est entachée de nullité.
ALCOOL
Cf. Alcoolisme*, Bastonnade (exemple)*, Débits de boissons*, Instigation* de mineur à boire de l’alcool, Ivresse*, Stupéfiants*.
![]() Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-301 et
s., p.221 et s.
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-301 et
s., p.221 et s.
![]() Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants
et des adolescents », n° 444 et s., p.298 et s.
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants
et des adolescents », n° 444 et s., p.298 et s.
- Notion. Au sens strict, l’alcool est une boisson au taux alcoolique élevé, comme l'armagnac, le calvados ou le cognac. Mais, au regard du droit pénal, est une boisson alcoolique toute boisson comportant de l'alcool et susceptible de causer l'état d'ivresse, comme le vin, la bière ou le cidre.
![]() A. Vitu (Traité de droit pénal spécial) distingue avec le
législateur, les boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel), les apéritifs et liqueurs (apéritifs à base de vin, liqueur
de cassis, liqueur de framboise), les boissons distillées (alcools provenant de la distillation des vins, cidres ou poirés), les autres boissons
alcooliques (whisky, vodka et autres alcools de grain) ... et rappelle l'interdiction de certaines boissons telle l'absinthe.
A. Vitu (Traité de droit pénal spécial) distingue avec le
législateur, les boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel), les apéritifs et liqueurs (apéritifs à base de vin, liqueur
de cassis, liqueur de framboise), les boissons distillées (alcools provenant de la distillation des vins, cidres ou poirés), les autres boissons
alcooliques (whisky, vodka et autres alcools de grain) ... et rappelle l'interdiction de certaines boissons telle l'absinthe.
![]() Bouillier (Questions de morale) : Celui qui, la raison
égarée par le vin ou l'alcool, frappe, incendie, tue, pendant un accès d'ivresse, ne sait plus ce qu'il fait.
Bouillier (Questions de morale) : Celui qui, la raison
égarée par le vin ou l'alcool, frappe, incendie, tue, pendant un accès d'ivresse, ne sait plus ce qu'il fait.
![]() Trib.civ.
Liège 25 novembre 1960 (Jur. Liège 1960-1961 p.125) :
Par les mots "boissons enivrantes" il faut entendre toutes
celles dont la teneur en alcool est suffisante pour parvenir à
provoquer l'ivresse ; il en est ainsi des spiritueux, des
boissons alcooliques obtenues par fermentation, des bières
fortes et des vins.
Trib.civ.
Liège 25 novembre 1960 (Jur. Liège 1960-1961 p.125) :
Par les mots "boissons enivrantes" il faut entendre toutes
celles dont la teneur en alcool est suffisante pour parvenir à
provoquer l'ivresse ; il en est ainsi des spiritueux, des
boissons alcooliques obtenues par fermentation, des bières
fortes et des vins.
- Publicité en faveur de l’alcool. Les art. L.3323-2 et s. du Code de la sécurité publique limitent la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
![]() Cass.crim. 18 mai 1994 (Gaz.Pal. 1994 II somm.
543) : Ne comportant aucune prohibition générale de la publicité en faveur de des boissons alcooliques, mais la réglementant quant à son contenu
et aux supports susceptibles de la diffuser, les dispositions légales françaises ne sont pas disproportionnées à l’objectif poursuivi de modération de la
consommation d’alcool et de la protection de la jeunesse.
Cass.crim. 18 mai 1994 (Gaz.Pal. 1994 II somm.
543) : Ne comportant aucune prohibition générale de la publicité en faveur de des boissons alcooliques, mais la réglementant quant à son contenu
et aux supports susceptibles de la diffuser, les dispositions légales françaises ne sont pas disproportionnées à l’objectif poursuivi de modération de la
consommation d’alcool et de la protection de la jeunesse.
![]() Cass.crim.
20 octobre 2011, n° 10-23.509 : La publicité autorisée
en faveur de boissons alcooliques est limitée à l’indication du
degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de
la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant,
des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration,
des modalités de vente et du mode de consommation du produit ;
qu’elle peut seulement comporter, outre ces indications, des
références relatives aux terroirs de production, aux
distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que
définies à l’art. L. 115-1 C.consommation ou aux indications
géographiques telles que définies dans les conventions et
traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des
références objectives relatives à la couleur et aux
caractéristiques olfactives et gustatives du produit ;
Cass.crim.
20 octobre 2011, n° 10-23.509 : La publicité autorisée
en faveur de boissons alcooliques est limitée à l’indication du
degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de
la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant,
des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration,
des modalités de vente et du mode de consommation du produit ;
qu’elle peut seulement comporter, outre ces indications, des
références relatives aux terroirs de production, aux
distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que
définies à l’art. L. 115-1 C.consommation ou aux indications
géographiques telles que définies dans les conventions et
traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des
références objectives relatives à la couleur et aux
caractéristiques olfactives et gustatives du produit ;
Pour rejeter la demande de l’ANPAA visant au retrait des
mentions et visuels le sablier, “les sens”, “l’originalité”,
“les hommes”, “le savoir-faire”, la cour d’appel a constaté
qu’apparaissait sur le site une animation représentant un
sablier en verre, composé de deux cubes translucides contenant
un liquide ambré, que le terme “les sens” était utilisé pour
faire trouver au participant la bonne association culinaire
entre chaque type de Single Malt et des plats proposés, que sous
le titre “l’originalité”, il lui était proposé de retrouver, à
partir d’arômes et saveurs défilant à l’écran, ceux qui
composent les quatre Single Malt Glenfiddich, que pour
participer au jeu-concours “hommes”, il lui fallait trouver quel
métier n’existe pas parmi les huit métiers présentés de la
distillerie ;
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations
qu’aucun des éléments litigieux ne constituait une simple
indication et que, dans le contexte du jeu-concours présenté sur
le site qui visait à promouvoir une image d’excellence des
produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les
références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et
gustatives du produit dépassaient les limites de l’objectivité,
la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Alcool frelaté. Il est hélas
fréquent que, afin d'accroître leurs bénéfices, les entreprises
ou les personnes produisant une boisson alcoolique l'allonge ou
la falsifie en y ajoutant des produits peu onéreux mais parfois
dangereux pour la santé.
Cette falsification tombe sous le coup de l'art. L.213-3 du Code
de la consommation en vertu duquel encourent deux ans de prison
et une amende de 300.000 € ceux qui falsifient des boissons...
destinées à être vendues (sous réserve des peines applicables au
cas où un consommateur viendrait à tomber malade, à subir une
infirmité permanente ou même à décéder).
![]() Jeandidier (Droit
pénal des affaires) : L'élément matériel du délit est la
falsification, concept signifiant une altération des qualités
essentielles de la marchandise, ou, pour reprendre la formule
d'un arrêt récent, le recours à une manipulation ou à un
traitement illicite ou non conforme à la réglementation en
vigueur, de nature à en altérer la constitution physique.
Jeandidier (Droit
pénal des affaires) : L'élément matériel du délit est la
falsification, concept signifiant une altération des qualités
essentielles de la marchandise, ou, pour reprendre la formule
d'un arrêt récent, le recours à une manipulation ou à un
traitement illicite ou non conforme à la réglementation en
vigueur, de nature à en altérer la constitution physique.
![]() Cass.crim.
3 mai 1957 (Bull.crim. n° 355 p.642) : Constitue une
falsification de boissons le mouillage de moûts en fermentation.
Cass.crim.
3 mai 1957 (Bull.crim. n° 355 p.642) : Constitue une
falsification de boissons le mouillage de moûts en fermentation.
![]() Exemple
(Ouest-France 9 mai 2014) : 80 personnes sont mortes au
Kenya, depuis lundi, après avoir bu de l'alcool frelaté. Plus de
180 restent hospitalisées... « Nous avons testé des
échantillons, a déclaré le ministre de la Santé. Nous avons
trouvé un fort pourcentage de méthanol ».
Exemple
(Ouest-France 9 mai 2014) : 80 personnes sont mortes au
Kenya, depuis lundi, après avoir bu de l'alcool frelaté. Plus de
180 restent hospitalisées... « Nous avons testé des
échantillons, a déclaré le ministre de la Santé. Nous avons
trouvé un fort pourcentage de méthanol ».
ALCOOLISME
Cf. Addiction*, Alcool*, Conduite automobile*, Débits de boissons*, Dipsomanie*, Ivresse*, Publicité commerciale*, Vices*, Zones protégées*.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-143 3°, p.256 /
II-215, p.340 / II-218, p.344
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-143 3°, p.256 /
II-215, p.340 / II-218, p.344
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-II-213,
p.244 / n° I-II-II-214, p.246
Voir :
Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-II-213,
p.244 / n° I-II-II-214, p.246
![]() Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine », n°
I-441, p.229
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine », n°
I-441, p.229
![]() Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants
et des adolescents », n° 444 et s., p.298 et s.
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants
et des adolescents », n° 444 et s., p.298 et s.
![]() Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n°
I-II-302 et s., p.221 et s.
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n°
I-II-302 et s., p.221 et s.
![]() Voir :
Tableau des incriminations
luttant contre l'alcoolisme (selon la science criminelle)
Voir :
Tableau des incriminations
luttant contre l'alcoolisme (selon la science criminelle)
![]() Voir :
Tableau des incriminations protégeant les mineurs
(selon la science criminelle)
Voir :
Tableau des incriminations protégeant les mineurs
(selon la science criminelle)
![]() Voir :
Tableau des
incriminations luttant contre l'alcoolisme (en droit positif français)
Voir :
Tableau des
incriminations luttant contre l'alcoolisme (en droit positif français)
- Notion. L’abus d’alcool peut être soit occasionnel, on parle alors d’état d’ivresse*, soit permanent, on parle alors d’alcoolisme chronique (ou d’ivrognerie dans le langage courant).
![]() Thomas (Cours de philosophie morale) : L'alcoolisme
est une état de dégénérescence physique et moral dû à l'abus de boissons alcooliques.
Thomas (Cours de philosophie morale) : L'alcoolisme
est une état de dégénérescence physique et moral dû à l'abus de boissons alcooliques.
![]() Danger (Ouest-France
1er février 2014) : Selon une étude publiée par la revue "The
Lancet", la vodka joue un rôle majeur dans les décès prématurés
des hommes russes de moins de 55 ans. Selon les chiffres
officiels russes, l'alcoolisme tue environ 500.000 personnes par
an et se répercute sur l'espérance de vie des hommes qui ne
dépasse pas 63 ans.
Danger (Ouest-France
1er février 2014) : Selon une étude publiée par la revue "The
Lancet", la vodka joue un rôle majeur dans les décès prématurés
des hommes russes de moins de 55 ans. Selon les chiffres
officiels russes, l'alcoolisme tue environ 500.000 personnes par
an et se répercute sur l'espérance de vie des hommes qui ne
dépasse pas 63 ans.
- Règle morale. Sur ce point la doctrine est unanime : dès lors que l'alcoolisme fait perdre à la personne qui y sombre l'usage de sa raison et sa dignité d'être humain, il doit être fermement condamné.
![]() Règle de St Benoît (Chap. 4 - Quels sont les instruments
pour bien agir ?). N° 35 : Ne pas s'adonner à la boisson.
Règle de St Benoît (Chap. 4 - Quels sont les instruments
pour bien agir ?). N° 35 : Ne pas s'adonner à la boisson.
![]() Hobbes (Le citoyen) : Celui qui fait sciemment
des choses qui obscurcissent l’usage de la raison se rend coupable envers les lois de la nature... L’ivrognerie pèche contre la vingtième loi de la
nature.
Hobbes (Le citoyen) : Celui qui fait sciemment
des choses qui obscurcissent l’usage de la raison se rend coupable envers les lois de la nature... L’ivrognerie pèche contre la vingtième loi de la
nature.
![]() Vittrant (Théologie morale) : La gourmandise est
l'usage immodéré du manger et du boire ... Le plaisir qui accompagne le boire et le mange est naturel, et il ne peut être interdit d'en jouir lorsque
l'on mange et boit raisonnablement ... même - ce qui est une fin naturelle de l'usage des comestibles et boissons - pour entretenir un état d'euphorie
souhaitable au point de vue personnel ou social.
Vittrant (Théologie morale) : La gourmandise est
l'usage immodéré du manger et du boire ... Le plaisir qui accompagne le boire et le mange est naturel, et il ne peut être interdit d'en jouir lorsque
l'on mange et boit raisonnablement ... même - ce qui est une fin naturelle de l'usage des comestibles et boissons - pour entretenir un état d'euphorie
souhaitable au point de vue personnel ou social.
![]() Pierre
et Martin (Cours de morale pour l'enseignement primaire) : L'alcoolisme
est un empoisonnement plus ou moins rapide par les boissons à
base d'alcool. C'est une des habitudes les plus dangereuses ;
elle compromet la santé, la vie et la moralité ; nul autre excès
n'exerce autant de ravages, nul n'a des conséquences plus graves
pour ceux qui s'y livrent, pour leur famille, leur entourage et
la société toute entière [il en va évidemment de même de la
toxicomanie].
Pierre
et Martin (Cours de morale pour l'enseignement primaire) : L'alcoolisme
est un empoisonnement plus ou moins rapide par les boissons à
base d'alcool. C'est une des habitudes les plus dangereuses ;
elle compromet la santé, la vie et la moralité ; nul autre excès
n'exerce autant de ravages, nul n'a des conséquences plus graves
pour ceux qui s'y livrent, pour leur famille, leur entourage et
la société toute entière [il en va évidemment de même de la
toxicomanie].
- Science criminelle. Les deux formes de l’alcoolisme sont également criminogènes ; mais elles ne posent pas les mêmes problèmes aux pouvoirs publics.
![]() Gassin (Criminologie) : La
sous-ivresse, qui s’accompagne d’une diminution de l’attention et d’un allongement du temps de réaction, entraîne une moindre sûreté des réponses
réflexes et est à l’origine d’un nombre considérable d’infractions d’imprudence. ; l’ivresse proprement dite, par
l’agressivité qu’elle provoque, l’exaspération des besoins sexuels qu’elle entraîne et les délires qui en résultent, est à l’origine d’une partie des
délits d’homicide et blessures volontaires, d’attentats à la pudeur, de rébellion etc. L’alcoolisme chronique agit non
seulement sur le foi (cirrhose), mais sur le système nerveux : d’une part il modifie le fonds mental de l’individu, dont il développe l’agressivité
et l’impulsivité et fait perdre le sens éthique, d’où les vols, grivèlerie, abus de confiance, abandon de famille, mais aussi des homicides et des
sévices à enfants ; d’autre part, il est à l’origine d’épisodes délirants aigus (delirium tremens) de sorte que, pour échapper aux dangers dont il
se croit menacé au cours de sa crise, il commet des meurtres et des coups et blessures.
Gassin (Criminologie) : La
sous-ivresse, qui s’accompagne d’une diminution de l’attention et d’un allongement du temps de réaction, entraîne une moindre sûreté des réponses
réflexes et est à l’origine d’un nombre considérable d’infractions d’imprudence. ; l’ivresse proprement dite, par
l’agressivité qu’elle provoque, l’exaspération des besoins sexuels qu’elle entraîne et les délires qui en résultent, est à l’origine d’une partie des
délits d’homicide et blessures volontaires, d’attentats à la pudeur, de rébellion etc. L’alcoolisme chronique agit non
seulement sur le foi (cirrhose), mais sur le système nerveux : d’une part il modifie le fonds mental de l’individu, dont il développe l’agressivité
et l’impulsivité et fait perdre le sens éthique, d’où les vols, grivèlerie, abus de confiance, abandon de famille, mais aussi des homicides et des
sévices à enfants ; d’autre part, il est à l’origine d’épisodes délirants aigus (delirium tremens) de sorte que, pour échapper aux dangers dont il
se croit menacé au cours de sa crise, il commet des meurtres et des coups et blessures.
Quant à la première, le législateur peut se demander si l’état d’ivresse doit ou non être considéré comme une circonstance aggravante du délit commis
sous son empire (pour autant que l’agent se soit sciemment placé dans un situation où il se savait dangereux pour autrui). Voir :
Ivresse*.
Quant à la seconde, qui comporte un état dangereux permanent, l’opinion dominante conseille un placement dans un établissement spécialisé (voir le Code
de la santé publique) ; cet internement des alcooliques constitue le type même de la mesure de sûreté et de sécurité publique (rapprocher, sur les
pouvoirs du juge d’instruction : l’art. 138-10° C.pr.pén.).
![]() Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Les textes
du Code de la santé publique établissent une véritable mesure de sûreté applicable ante delictum sur la seule constatation de l’état dangereux de
l’intéressé, et sans qu’il soit nécessaire qu’une infraction ait été commise.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Les textes
du Code de la santé publique établissent une véritable mesure de sûreté applicable ante delictum sur la seule constatation de l’état dangereux de
l’intéressé, et sans qu’il soit nécessaire qu’une infraction ait été commise.
![]() Code pénal suisse (état en 2003), art. 44 :
Si le délinquant est alcoolique et que l’infraction commise soit en rapport avec cet état, le juge pourra l’interner dans un établissement pour
alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour prévenir de nouveaux crimes ou délits. Le juge pourra aussi ordonner un traitement
ambulatoire.
Code pénal suisse (état en 2003), art. 44 :
Si le délinquant est alcoolique et que l’infraction commise soit en rapport avec cet état, le juge pourra l’interner dans un établissement pour
alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour prévenir de nouveaux crimes ou délits. Le juge pourra aussi ordonner un traitement
ambulatoire.
ALIAS
Cf. Faux nom*, Nom*, Pseudonyme*.
Du latin "alias" : autrement. En droit criminel, les "alias" sont les différents noms qu'une personne emploie dans l'exercice de ses activités délictueuses, ou sous lesquels elle est connue dans certains milieux.
![]() Code de procédure pénale. Article R53-8-7 : Pour
chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes : 1º Informations relatives à
la personne elle-même : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement
de nom et nom d'usage...
Code de procédure pénale. Article R53-8-7 : Pour
chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes : 1º Informations relatives à
la personne elle-même : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement
de nom et nom d'usage...
![]() Code criminel des "Colville Confederated tribes".
3-1-265 - Registre des délinquants sexuels : L'intéressé doit indiqué au service de police tribal ... (1) Nom ; (2) adresse ; (3) date date et lieu de
naissance ; (4) adresse du lieu de travail ; (5) infraction pour laquelle il a été condamné ; (6) date et lieu de la condamnation ; (7) alias
employés...
Code criminel des "Colville Confederated tribes".
3-1-265 - Registre des délinquants sexuels : L'intéressé doit indiqué au service de police tribal ... (1) Nom ; (2) adresse ; (3) date date et lieu de
naissance ; (4) adresse du lieu de travail ; (5) infraction pour laquelle il a été condamné ; (6) date et lieu de la condamnation ; (7) alias
employés...
![]() Trib.corr. Paris 10 juillet 1991 (Gaz.Pal.
1992 I 20) : La totalité du capital était acquise aux États-unis par les prévenus par l'intermédiaire de prête-noms ou sous des alias.
Trib.corr. Paris 10 juillet 1991 (Gaz.Pal.
1992 I 20) : La totalité du capital était acquise aux États-unis par les prévenus par l'intermédiaire de prête-noms ou sous des alias.
![]() Agnel (Curiosités judiciaires) : Déclarons la
truie de Jean Bailli, alias (autrement dit) Valot, pour raison du meurtre et homicide par icelle truie commis... devoir être pendue par les pieds de
derrière.
Agnel (Curiosités judiciaires) : Déclarons la
truie de Jean Bailli, alias (autrement dit) Valot, pour raison du meurtre et homicide par icelle truie commis... devoir être pendue par les pieds de
derrière.
![]() Encyclopédie Microsoft Encarta : Trotski fut
assassiné en août 1940 à Coyoacán, au Mexique, par un agent du service secret du Guépéou, Ramón Mercader (alias Jacques Mornard) qui lui défonça le crâne
à coups de pistolet.
Encyclopédie Microsoft Encarta : Trotski fut
assassiné en août 1940 à Coyoacán, au Mexique, par un agent du service secret du Guépéou, Ramón Mercader (alias Jacques Mornard) qui lui défonça le crâne
à coups de pistolet.
ALIBI
Cf. Preuve*.
Littré définit exactement l’alibi comme la présence d’une personne dans un autre lieu que celui où a été accomplie l’infraction dont on l’accuse. En règle générale ce moyen de preuve est concluant, à moins qu’il ne repose sur un témoignage douteux.
![]() De Ferrière (Dictionnaire de droit) : Alibi, mot latin
qui signifie ailleurs. Quand on dit qu’un accusé propose l’alibi, cela signifie qu’il allègue qu’il était dans un autre lieu que celui où le crime a été
commis. Par exception, on peut prouver l’alibi par les domestiques.
De Ferrière (Dictionnaire de droit) : Alibi, mot latin
qui signifie ailleurs. Quand on dit qu’un accusé propose l’alibi, cela signifie qu’il allègue qu’il était dans un autre lieu que celui où le crime a été
commis. Par exception, on peut prouver l’alibi par les domestiques.
![]() Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Terme dont on se
sert en style de procédure criminelle pour signifier l'absence de l'accusé, par rapport au lieu où on l'accuse d'avoir commis le crime ou le délit.
Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Terme dont on se
sert en style de procédure criminelle pour signifier l'absence de l'accusé, par rapport au lieu où on l'accuse d'avoir commis le crime ou le délit.
![]() Lombroso (L’homme criminel) : Rognoni tue son frère et
se procure un alibi; mais il oublie de laver les taches de sang dont son habit est souillé.
Lombroso (L’homme criminel) : Rognoni tue son frère et
se procure un alibi; mais il oublie de laver les taches de sang dont son habit est souillé.
![]() Cass.crim. 22 mai 1984 (Bull.crim. n°187
p.482) : Pour déclarer à bon droit la prévenue coupable de complicité d’incendie d'un bien immobilier, la Cour d’appel relève qu'elle s'était
arrangée pour que l'immeuble soit vide de tout occupant, qu'après avoir donné congé pour une semaine au personnel et déménagé certains objets, elle était
ostensiblement partie en voyage pour quelques jours en compagnie de son concubin, que celui-ci était revenu par avion sous un nom d'emprunt pour
commettre son forfait et que, des policiers locaux ayant téléphoné au lieu de son déplacement pour l'informer du sinistre, la prévenue leur avait
faussement déclaré que son ami se trouvait à ses côtés, essayant ainsi de lui fournir un alibi.
Cass.crim. 22 mai 1984 (Bull.crim. n°187
p.482) : Pour déclarer à bon droit la prévenue coupable de complicité d’incendie d'un bien immobilier, la Cour d’appel relève qu'elle s'était
arrangée pour que l'immeuble soit vide de tout occupant, qu'après avoir donné congé pour une semaine au personnel et déménagé certains objets, elle était
ostensiblement partie en voyage pour quelques jours en compagnie de son concubin, que celui-ci était revenu par avion sous un nom d'emprunt pour
commettre son forfait et que, des policiers locaux ayant téléphoné au lieu de son déplacement pour l'informer du sinistre, la prévenue leur avait
faussement déclaré que son ami se trouvait à ses côtés, essayant ainsi de lui fournir un alibi.
![]() Exemple (Le Télégramme, 20-1-2004) :Un
automobiliste de Libourne (Gironde) a été flashé à deux reprises par un radar automatique des Landes le soir de Noël alors qu’il fêtait le réveillon en
famille à son domicile. Il tente depuis lors de récupérer les clichés afin de prouver son innocence.
Exemple (Le Télégramme, 20-1-2004) :Un
automobiliste de Libourne (Gironde) a été flashé à deux reprises par un radar automatique des Landes le soir de Noël alors qu’il fêtait le réveillon en
famille à son domicile. Il tente depuis lors de récupérer les clichés afin de prouver son innocence.
ALIÉNATION MENTALE - Voir : Démence*.
ALIMENTS - Voir : Falsification*.
![]() Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-260,
p.564 (sur les aliments dangereux pour la santé)
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-260,
p.564 (sur les aliments dangereux pour la santé)
ALLÉGATION
Cf. Action civile (recevabilité)*, Diffamation*, Preuve*.
Une allégation, ou assertion, consiste à avancer une prétention, un argument, une preuve. Elle ne saurait produire effet devant les tribunaux que si elle s'appuie sur des éléments lui conférant une certaine crédibilité, et permettant en conséquence de la retenir comme hypothèse de travail.
![]() Du Boys (Histoire du droit criminel des peuples anciens) :
À défaut de preuves, les anciens multipliaient les imputations les plus odieuses, les griefs les plus chimériques contre celui qu'ils voulaient
perdre, mais Jésus ne daigna pas même répondre à toutes ces vaines allégations.
Du Boys (Histoire du droit criminel des peuples anciens) :
À défaut de preuves, les anciens multipliaient les imputations les plus odieuses, les griefs les plus chimériques contre celui qu'ils voulaient
perdre, mais Jésus ne daigna pas même répondre à toutes ces vaines allégations.
![]() Bentham (Traité des preuves judiciaires) : Il faut se
défier extrêmement des préjugés, fondés sur des allégations sans preuves.
Bentham (Traité des preuves judiciaires) : Il faut se
défier extrêmement des préjugés, fondés sur des allégations sans preuves.
![]() Faustin Hélie (Traité de l'instruction criminelle) : Il ne
suffit pas d'alléguer une lésion, il faut en préciser la nature et la gravité pour que le droit d'exercer l'action civile soit ouvert.
Faustin Hélie (Traité de l'instruction criminelle) : Il ne
suffit pas d'alléguer une lésion, il faut en préciser la nature et la gravité pour que le droit d'exercer l'action civile soit ouvert.
![]() Essaïd (La présomption d'innocence) : Si le prévenu allègue
une circonstance qui exclut sa responsabilité, et si cette allégation n'est pas dépourvue de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe
au ministère public d'en prouver l'inexactitude.
Essaïd (La présomption d'innocence) : Si le prévenu allègue
une circonstance qui exclut sa responsabilité, et si cette allégation n'est pas dépourvue de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe
au ministère public d'en prouver l'inexactitude.
![]() Code de procédure pénale espagnol. Art. 669 : Les
représentants des parties ... répondront dans le délai de trois jours, en accompagnant cette réponse des documents qui fondent leurs allégations.
Code de procédure pénale espagnol. Art. 669 : Les
représentants des parties ... répondront dans le délai de trois jours, en accompagnant cette réponse des documents qui fondent leurs allégations.
![]() Cass.crim. 9 mars 2004 (Gaz.Pal. 2004 somm. 3309) :
La partie civile, qui ne peut alléguer aucun préjudice direct résultant de l'infraction, ne peut mettre en mouvement l'action publique et le pourvoi
qu'elle forme, après relaxe du prévenu et rejet de ses demandes, est irrecevable.
Cass.crim. 9 mars 2004 (Gaz.Pal. 2004 somm. 3309) :
La partie civile, qui ne peut alléguer aucun préjudice direct résultant de l'infraction, ne peut mettre en mouvement l'action publique et le pourvoi
qu'elle forme, après relaxe du prévenu et rejet de ses demandes, est irrecevable.
![]() Cass.crim. 10 novembre 2004 (Gaz.Pal. 2005 somm.
1336) : Le moyen pris d'une durée successive des débats sans que l'accusé ait pu prendre aucun repos reste, en l'absence de donné acte, qu'il
appartenait à l'accusé ou à son avocat de réclamer s'il l'estimait utile à sa défense, à l'état de simple allégation et ne saurait donc être
accueilli.
Cass.crim. 10 novembre 2004 (Gaz.Pal. 2005 somm.
1336) : Le moyen pris d'une durée successive des débats sans que l'accusé ait pu prendre aucun repos reste, en l'absence de donné acte, qu'il
appartenait à l'accusé ou à son avocat de réclamer s'il l'estimait utile à sa défense, à l'état de simple allégation et ne saurait donc être
accueilli.
AMALGAME
Cf. Fournées*, Tribunal révolutionnaire*.
La technique de l’amalgame consiste, de la part d’une partie poursuivante, à joindre dans une même audience deux causes qui n’ont que de lointains rapports ; et ce afin de placer la personne que l’on veut perdre sur le même banc que de fieffés coquins. Notamment, en faisant asseoir un droit commun à côté d’un politique, on contamine celui-ci (surtout si on ne lui a pas laissé faire sa toilette et s’habiller décemment).
- Ainsi Robespierre fit comparaître Danton devant le Tribunal révolutionnaire en même temps que des agioteurs de la Compagnie des Indes ; la durée de l’audience étant fixée à trois jours, le temps d’expliquer cette délicate affaire, il ne resta plus à Danton que quelques instants pour prendre la parole.
![]() Wallon (Histoire du Tribunal
révolutionnaire) : Que l’affaire Danton, Desmoulins, Lacroix et Philippeaux ait été jointe à celle de Cabot, Bazire et autres (affaire des
agioteurs de la Compagnie des Indes), cela ne pouvait venir que de la pensée de déshonorer la cause des premiers par cette association avec des actes de
friponnerie ; en un mot de faire du procès des uns et des autres un procès de corrompus.
Wallon (Histoire du Tribunal
révolutionnaire) : Que l’affaire Danton, Desmoulins, Lacroix et Philippeaux ait été jointe à celle de Cabot, Bazire et autres (affaire des
agioteurs de la Compagnie des Indes), cela ne pouvait venir que de la pensée de déshonorer la cause des premiers par cette association avec des actes de
friponnerie ; en un mot de faire du procès des uns et des autres un procès de corrompus.
![]() Wallon (Histoire du Tribunal
révolutionnaire) : Pour le jugement de l’affaire de Verdun, où comparaissaient sept jeunes filles de 17 à 26 ans (au jour du jugement) à qui on
reprochait d’avoir offert autrefois des dragées au roi de Prusse, on joignit, à celles que l’on nommait déjà « les vierges de Verdun », la
fille Croute, une fille publique presque toujours ivre : elle avait tenu des propos injurieux pour la milice qu’elle appelait crapauds bleus. Rien
de commun avec l’affaite de Verdun ; mais il ne déplaisait pas de la joindre aux dames et jeunes filles qui allaient comparaître devant le
Tribunal : c’était en souillant les autres par cette association, une bonne occasion de s’en débarrasser.
Wallon (Histoire du Tribunal
révolutionnaire) : Pour le jugement de l’affaire de Verdun, où comparaissaient sept jeunes filles de 17 à 26 ans (au jour du jugement) à qui on
reprochait d’avoir offert autrefois des dragées au roi de Prusse, on joignit, à celles que l’on nommait déjà « les vierges de Verdun », la
fille Croute, une fille publique presque toujours ivre : elle avait tenu des propos injurieux pour la milice qu’elle appelait crapauds bleus. Rien
de commun avec l’affaite de Verdun ; mais il ne déplaisait pas de la joindre aux dames et jeunes filles qui allaient comparaître devant le
Tribunal : c’était en souillant les autres par cette association, une bonne occasion de s’en débarrasser.
![]() Fouquier-Tinville (Plaidoirie de défense) :
Je conviens d’avoir traduit par amalgame plusieurs accusés pour des faits qui leur étaient étrangers ; mais c’était sur les ordres du Comité du
gouvernement.
Fouquier-Tinville (Plaidoirie de défense) :
Je conviens d’avoir traduit par amalgame plusieurs accusés pour des faits qui leur étaient étrangers ; mais c’était sur les ordres du Comité du
gouvernement.
- La pratique de l'amalgame, et même celle des jugements collectifs (hors les cas de complot ou d'association de malfaiteurs), est à l'évidence proscrite dans le cadre d'une saine justice.
![]() Xénophon (Les Mémorables) :
Devenu épistate de l’assemblée populaire, et le peuple
voulant, contrairement aux lois, condamner à mort collectivement
par un seul vote neuf généraux ... Socrate refusa de faire
procéder au vote, malgré la colère du peuple et les menaces d’un
grand nombre de puissants citoyens ; il préféra demeurer fidèle
à son serment que de complaire à la multitude au mépris de
la justice et en dépit des menaces.
Xénophon (Les Mémorables) :
Devenu épistate de l’assemblée populaire, et le peuple
voulant, contrairement aux lois, condamner à mort collectivement
par un seul vote neuf généraux ... Socrate refusa de faire
procéder au vote, malgré la colère du peuple et les menaces d’un
grand nombre de puissants citoyens ; il préféra demeurer fidèle
à son serment que de complaire à la multitude au mépris de
la justice et en dépit des menaces.
AMBASSADEUR
Cf. Agents consulaires*, Agents diplomatiques*, Immunité diplomatique*.
Les ambassadeurs sont des Agents diplomatiques* de premier niveau. En général, ils sont chargés de représenter l’État qui les accrédite auprès d’un État étranger.
![]() Cass.crim. 4 janvier 1990 (Gaz.Pal. 1990 II
Chr.crim. 377) : Pour rejeter les conclusions de l’inculpé qui, invoquant un ordre de mission de la République du Bénin et sa qualité
d’ambassadeur itinérant, revendiquait le bénéfice de l’immunité diplomatique résultant de l’art. 40 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, la
Chambre d’accusation énonce à bon droit que « ce texte qui a minutieusement réglementé la question du transit des agents diplomatiques dans un État tiers
ne leur accorde l’immunité de juridiction que lorsqu’ils rejoignent leur poste ou rentrent dans leur pays en empruntant le territoire d’un État qui n’est
ni celui de l’envoi ni celui dans lequel ils sont ou étaient accrédités ».
Cass.crim. 4 janvier 1990 (Gaz.Pal. 1990 II
Chr.crim. 377) : Pour rejeter les conclusions de l’inculpé qui, invoquant un ordre de mission de la République du Bénin et sa qualité
d’ambassadeur itinérant, revendiquait le bénéfice de l’immunité diplomatique résultant de l’art. 40 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, la
Chambre d’accusation énonce à bon droit que « ce texte qui a minutieusement réglementé la question du transit des agents diplomatiques dans un État tiers
ne leur accorde l’immunité de juridiction que lorsqu’ils rejoignent leur poste ou rentrent dans leur pays en empruntant le territoire d’un État qui n’est
ni celui de l’envoi ni celui dans lequel ils sont ou étaient accrédités ».
La Chambre d’accusation énonce à bon droit que l’appelant, qui se prévaut de la qualité de Français dans des circonstances que l’information devra
éclaircir, qui ne figure pas sur la liste diplomatique du ministère des Affaires étrangères ainsi que cela a été vérifié, qui a lui-même déclaré qu’il
était en congé ou disponibilité, qui vivait en France et qui invoque un ordre de mission qui ne lui confère aucune mission internationale précise, ne
peut invoquer le bénéfice de l’immunité diplomatique.
Afin d'assurer les bonnes relations internationales d'une nation, son législateur octroie ordinairement aux ambassadeurs d'un pays étranger un régime privilégié (voir notamment Immunité diplomatique*).
![]() Blackstone (Commentaires sur les lois anglaises) : Un
statut de la Reine Anne ordonne que quiconque attenterait à la personne d’un ambassadeur ou de sa suite… serait déclaré violateur du droit des gens,
perturbateur du repose public, et comme tel condamné à souffrir telle peine corporelle qui serait ordonnée par les juges.
Blackstone (Commentaires sur les lois anglaises) : Un
statut de la Reine Anne ordonne que quiconque attenterait à la personne d’un ambassadeur ou de sa suite… serait déclaré violateur du droit des gens,
perturbateur du repose public, et comme tel condamné à souffrir telle peine corporelle qui serait ordonnée par les juges.
![]() Code
annamite des Lé. Art. 437 : Ceux qui se rendront
coupables de vol au préjudice d'un ambassadeur d'un pays
étranger seront punis des peines prévues pour le vol ordinaire,
avec augmentation d'un degré.
Code
annamite des Lé. Art. 437 : Ceux qui se rendront
coupables de vol au préjudice d'un ambassadeur d'un pays
étranger seront punis des peines prévues pour le vol ordinaire,
avec augmentation d'un degré.
AMBIGUÏTÉ
Cf. Équivoque*.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° I-8, p.137 / n° I-246, p.260
/ n° II-215, p.339
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° I-8, p.137 / n° I-246, p.260
/ n° II-215, p.339
Un écrit ou un propos est ambigu lorsqu'il laisse planer un doute sur son sens exact. Il ne saurait donc, notamment, suffire à motiver une condamnation pénale.
![]() Dictionnaire de droit civil et de pratique (Paris
1687) : Ambiguïté, est ce que nous appelons plus communément équivoque. L’équité veut que les choses ambiguës et douteuses soient interprétées
favorablement.
Dictionnaire de droit civil et de pratique (Paris
1687) : Ambiguïté, est ce que nous appelons plus communément équivoque. L’équité veut que les choses ambiguës et douteuses soient interprétées
favorablement.
![]() St Thomas d'Aquin (Somme théologique) : Un signe qui
signifie plusieurs choses est un signe ambigu qui prête à l’erreur.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique) : Un signe qui
signifie plusieurs choses est un signe ambigu qui prête à l’erreur.
![]() Bréviaire d’Alaric, préambule : Avec l’aide de Dieu, nous
avons fait en sorte que toutes les obscurités des lois romaines et du droit antique soient dissipées, et qu’une plus grande clarté s’y répande, afin que
rien ne demeure ambigu, et ne soit pour les plaideurs un sujet de longues controverses.
Bréviaire d’Alaric, préambule : Avec l’aide de Dieu, nous
avons fait en sorte que toutes les obscurités des lois romaines et du droit antique soient dissipées, et qu’une plus grande clarté s’y répande, afin que
rien ne demeure ambigu, et ne soit pour les plaideurs un sujet de longues controverses.
![]() Cass.crim. 29 octobre 1985 (Gaz. Pal. 1986 I 9) :
La responsabilité du respect des consignes de sécurité ne saurait incomber directement à un chef de chantier à moins qu'il ne soit titulaire d'une
délégation de pouvoir certaine et dépourvue d'ambiguïté et qu'il ne dispose de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour assumer ses
obligations.
Cass.crim. 29 octobre 1985 (Gaz. Pal. 1986 I 9) :
La responsabilité du respect des consignes de sécurité ne saurait incomber directement à un chef de chantier à moins qu'il ne soit titulaire d'une
délégation de pouvoir certaine et dépourvue d'ambiguïté et qu'il ne dispose de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour assumer ses
obligations.
![]() Cass.crim. 14 février 1996 (Gaz. Pal. 1996 I Chr.
crim. 99) : Pour déclarer, à bon droit, la prévenue coupable du délit de publicité trompeuse, les juges du second degré relèvent que
« la présentation ambiguë des documents publicitaires était de nature à induire le consommateur moyen en erreur ».
Cass.crim. 14 février 1996 (Gaz. Pal. 1996 I Chr.
crim. 99) : Pour déclarer, à bon droit, la prévenue coupable du délit de publicité trompeuse, les juges du second degré relèvent que
« la présentation ambiguë des documents publicitaires était de nature à induire le consommateur moyen en erreur ».
![]() Taine (Les origines de la France contemporaine) :
Le 1er septembre, à l'instigation de Danton, Thuriot obtient de l'Assemblée nationale un décret ambigu qui semble permettre aux membres de la Commune
de siéger encore, au moins provisoirement, à l'Hôtel de Ville.
Taine (Les origines de la France contemporaine) :
Le 1er septembre, à l'instigation de Danton, Thuriot obtient de l'Assemblée nationale un décret ambigu qui semble permettre aux membres de la Commune
de siéger encore, au moins provisoirement, à l'Hôtel de Ville.
ÂME
Cf. Corps de l'homme*, Dignité de la personne humaine*, Homme*, la Pensée ( l'Esprit)*, Personne humaine*, Vie*.
- Notion. L'âme présente la particularité de conférer à l'être humain sa dignité particulière, mais d'échapper pourtant à toute définition unanimement reconnue. C'est dire que, lorsque ce terme est employé dans un écrit ou un propos, on ne peut guère se faire une idée du sens dans lequel il est compris qu'en le replaçant dans son contexte.
![]() Littré
(Dictionnaire) :
Âme - Principe immatériel de la vie... Ensemble des facultés
morales et intellectuelles.
Littré
(Dictionnaire) :
Âme - Principe immatériel de la vie... Ensemble des facultés
morales et intellectuelles.
![]() Larousse
(Dictionnaire des synonymes) :
Âme se dit, en dehors de toute considération religieuse ou
philosophique de l'ensemble des facultés intellectuelles et
surtout morales de l'homme.
Larousse
(Dictionnaire des synonymes) :
Âme se dit, en dehors de toute considération religieuse ou
philosophique de l'ensemble des facultés intellectuelles et
surtout morales de l'homme.
![]() Cuvillier
(Vocabulaire philosophique) :
Âme - Principe de la vie et de la pensée ; selon Aristote ,
les végétaux ont une âme nutritive, les animaux ont de plus une
âme sensitive et une âme motrice, l'homme seul possède une âme
pensante.
Cuvillier
(Vocabulaire philosophique) :
Âme - Principe de la vie et de la pensée ; selon Aristote ,
les végétaux ont une âme nutritive, les animaux ont de plus une
âme sensitive et une âme motrice, l'homme seul possède une âme
pensante.
- Nature de l'âme.
À l'inverse du Corps de l'homme*,
et même de sa partie la plus éminente qu'est le cerveau, l'âme ne
possède pas d'existence matérielle ; elle se caractérise tout au contraire par
son caractère immatériel et même immortel.
C'est pourquoi les doctrines matérialistes
n'admettent pas que l'homme ait une âme. Un chirurgien du temps de Pasteur a
proclamé que, tout au long de sa carrière, son bistouri n'avait
jamais rencontré cette chimère. Dans cette conception, quand la mort atteint l'être humain,
rien ne demeure plus de sa personne.
On a justement observé que, en niant l'existence d'une Âme
qui inviterait notre Esprit* à
observer en conscience les règles morales posées par la loi naturelle, les
doctrines matérialistes laissent place à une
politique sociale arbitraire, qui ne parvient à s'imposer que par le
recours à la force, et débouche inévitablement sur un régime totalitaire.
![]() La
Mettrie,
(L'homme-machine) : L'âme n'est qu'un vain terme dont on a
point d'idée, et dont un bon esprit ne doit se servir que pour
nommer la partie qui pense en nous.
La
Mettrie,
(L'homme-machine) : L'âme n'est qu'un vain terme dont on a
point d'idée, et dont un bon esprit ne doit se servir que pour
nommer la partie qui pense en nous.
![]() Fouché,
en 1793, avait fait graver cette inscription à l'entrée du
cimetière de Nevers : La mort est un sommeil éternel.
Fouché,
en 1793, avait fait graver cette inscription à l'entrée du
cimetière de Nevers : La mort est un sommeil éternel.
![]() Clemenceau (Au
soir de la pensée) : Un sommeil sans rêves, c'est-à-dire un
état d'inconscience qui ne peut se terminer que sous une forme
de négation, voilà tout ce que nous pouvons anticiper de la
mort... Que mon dernier mouvement de présomption soit d'apporter
ici la parole indépendante d'un passant, au soir de la pensée.
Clemenceau (Au
soir de la pensée) : Un sommeil sans rêves, c'est-à-dire un
état d'inconscience qui ne peut se terminer que sous une forme
de négation, voilà tout ce que nous pouvons anticiper de la
mort... Que mon dernier mouvement de présomption soit d'apporter
ici la parole indépendante d'un passant, au soir de la pensée.
![]() Ahrens
(Cours de droit naturel) : L'égarement de l'impérialisme
romain fut la dernière conséquence du polythéisme qui, en
brisant l'unité divine, amena, en dernier lieu la substitution
de l'homme à Dieu ; et la tendance prononcée de notre époque
vers l'impérialisme et le règne de la force constitue un signe
manifeste de notre décadence morale, amenée ou favorisée par
toutes les doctrines qui, en attaquant la croyance en Dieu et en
une âme immortelle responsable, finissent toujours de remplacer
la soumission libre à l'autorité morale de la conscience, par le
joug d'un pouvoir de contrainte extérieure ; car à mesure que
l'homme perd l'empire moral de soi, l'empire de la force brutale
prend de l'extension.
Ahrens
(Cours de droit naturel) : L'égarement de l'impérialisme
romain fut la dernière conséquence du polythéisme qui, en
brisant l'unité divine, amena, en dernier lieu la substitution
de l'homme à Dieu ; et la tendance prononcée de notre époque
vers l'impérialisme et le règne de la force constitue un signe
manifeste de notre décadence morale, amenée ou favorisée par
toutes les doctrines qui, en attaquant la croyance en Dieu et en
une âme immortelle responsable, finissent toujours de remplacer
la soumission libre à l'autorité morale de la conscience, par le
joug d'un pouvoir de contrainte extérieure ; car à mesure que
l'homme perd l'empire moral de soi, l'empire de la force brutale
prend de l'extension.
![]() Le
Bon
(Psychologie du socialisme) : L'homme moderne a fait les les
plus consciencieux efforts pour se soustraire au passé. Notre
grande Révolution croyait même pouvoir le rejeter
antérieurement. Combien vaines de telles tentatives ! On peur
conquérir un peuple, l'asservir, le détruire même. Où est le
pouvoir qui changerait son âme ?
Le
Bon
(Psychologie du socialisme) : L'homme moderne a fait les les
plus consciencieux efforts pour se soustraire au passé. Notre
grande Révolution croyait même pouvoir le rejeter
antérieurement. Combien vaines de telles tentatives ! On peur
conquérir un peuple, l'asservir, le détruire même. Où est le
pouvoir qui changerait son âme ?
Mais l'argument négatif tiré des sciences physiques n'est nullement déterminant. Les sciences métaphysiques peuvent en effet faire valoir nombre d'expériences vécues s'étant traduites par la séparation temporaire de l'âme et du corps. Il en est ainsi lorsque que l'âme quitte lentement du corps d'un mourant, comme à regret, puis le réintègre en un instant pour une raison qui nous demeure inconnue (on pense en particulier à une mission altruiste que le patient souhaite ardemment achever sur cette terre). Une telle expérience marque pour la vie celui qui l'a personnellement connue.
![]() Cuvillier
(Vocabulaire philosophique) :
Âme - Principe de la vie et de la pensée ; selon Aristote ,
les végétaux ont une âme nutritive, les animaux ont de plus une
âme sensitive et une âme motrice, l'homme seul possède une âme
pensante.
Cuvillier
(Vocabulaire philosophique) :
Âme - Principe de la vie et de la pensée ; selon Aristote ,
les végétaux ont une âme nutritive, les animaux ont de plus une
âme sensitive et une âme motrice, l'homme seul possède une âme
pensante.
![]() St
Augustin (De l'immortalité de l'âme) : Si l'âme n'est pas
unie en un lieu à un corps, qui, lui occupe un lieu, les
principes rationnels les plus hauts qui sont éternels et
demeurent sans mutation sans être limités à un lieu, c'est l'âme
qui les atteint avant le corps ; elle le fait non pas seulement,
mais davantage.
St
Augustin (De l'immortalité de l'âme) : Si l'âme n'est pas
unie en un lieu à un corps, qui, lui occupe un lieu, les
principes rationnels les plus hauts qui sont éternels et
demeurent sans mutation sans être limités à un lieu, c'est l'âme
qui les atteint avant le corps ; elle le fait non pas seulement,
mais davantage.
![]() François
Cheng, de l'Académie française (De l'âme, Paris 2016) : L'âme
a quelque chose d'originel, de natif, comportant une dimension
inconsciente, insondable pour ainsi dire, qui la relie au
mystère même qui à l'origine a présidé à l'avènement de
l'univers vivant.
François
Cheng, de l'Académie française (De l'âme, Paris 2016) : L'âme
a quelque chose d'originel, de natif, comportant une dimension
inconsciente, insondable pour ainsi dire, qui la relie au
mystère même qui à l'origine a présidé à l'avènement de
l'univers vivant.
![]() Carrel (L'homme,
cet inconnu) : L'âme est cet aspect de nous-mêmes qui est
spécifique de notre nature et nous distingue de tous les autres
êtres vivants.
Carrel (L'homme,
cet inconnu) : L'âme est cet aspect de nous-mêmes qui est
spécifique de notre nature et nous distingue de tous les autres
êtres vivants.
![]() Cuvillier
(Cours de philosophie, T.I) : Tant que l'âme est conçue plus
ou moins comme un principe vital, ses attaches avec le corps ne
sont pas rompues... À partir du moment au contraire, où l'âme
est définie comme pure pensée, comme esprit, le problème devient
difficile à résoudre. Pour Descartes, l'âme est une substance
dont toute la nature n'est que de penser.
Cuvillier
(Cours de philosophie, T.I) : Tant que l'âme est conçue plus
ou moins comme un principe vital, ses attaches avec le corps ne
sont pas rompues... À partir du moment au contraire, où l'âme
est définie comme pure pensée, comme esprit, le problème devient
difficile à résoudre. Pour Descartes, l'âme est une substance
dont toute la nature n'est que de penser.
![]() Lois
de Manou (I, 7) : Le Seigneur, que l'esprit seul peut percevoir, échappe aux organes des sens, qui est sans
parties visibles ; éternel, âme de tous les êtres, que nul ne
peut comprendre, il déploya sa propre splendeur dans un monde
encore plongé dans l'obscurité.
Lois
de Manou (I, 7) : Le Seigneur, que l'esprit seul peut percevoir, échappe aux organes des sens, qui est sans
parties visibles ; éternel, âme de tous les êtres, que nul ne
peut comprendre, il déploya sa propre splendeur dans un monde
encore plongé dans l'obscurité.
![]() Platon
(Apologie de Socrate) Socrate : N'as-tu pas honte de
chercher à acquérir la plus grande fortune possible, réputation
et honneurs, tandis que tu ne te soucies point de ta pensée, de
la vérité et de ton âme ?
Platon
(Apologie de Socrate) Socrate : N'as-tu pas honte de
chercher à acquérir la plus grande fortune possible, réputation
et honneurs, tandis que tu ne te soucies point de ta pensée, de
la vérité et de ton âme ?
![]() Platon (Les
lois, L.IV) : Nous devons obéir à la partie immortelle
de notre âme pour administrer nos maisons et nos cités, en
donnant le nom de lois aux préceptes émanés de la raison.
Platon (Les
lois, L.IV) : Nous devons obéir à la partie immortelle
de notre âme pour administrer nos maisons et nos cités, en
donnant le nom de lois aux préceptes émanés de la raison.
![]() St
Augustin (La Cité de Dieu, L. XII) : Dieu a fait l'homme à
son image, car il lui a donné une âme qui, par le privilège de
la raison et de l'intelligence l'élève au dessus de tous les
animaux ... en qui l'âme n'est point.
St
Augustin (La Cité de Dieu, L. XII) : Dieu a fait l'homme à
son image, car il lui a donné une âme qui, par le privilège de
la raison et de l'intelligence l'élève au dessus de tous les
animaux ... en qui l'âme n'est point.
![]() Encyclique
« Caritas in veritate
» : Dieu a fondé la dignité transcendante de l'homme
et alimente en lui la soif d’« être plus ». L’homme n’est pas un
atome perdu dans un univers de hasard, mais il est une créature
de Dieu, à qui Il a voulu donner une âme immortelle.
Encyclique
« Caritas in veritate
» : Dieu a fondé la dignité transcendante de l'homme
et alimente en lui la soif d’« être plus ». L’homme n’est pas un
atome perdu dans un univers de hasard, mais il est une créature
de Dieu, à qui Il a voulu donner une âme immortelle.
- Mission de l'âme. Le mot âme
dérive du terme latin anima, qui signifiait notamment :
âme, souffle et principe de vie. Les doctrines
spiritualistes, seules à y croire, lui accordent la plus grande importance
; les pénalistes voient notamment en elle le dépositaire : de la conscience d'un Au-delà, des notions de
Bien* et de Mal*,
et du caractère impératif des Devoirs*
de l'homme envers les autres êtres vivants et l'ensemble de
la nature. Qui ne connaît cette formule de Rabelais, dans son
Pantagruel : Science sans conscience, n'est que ruine de
l'âme ?
Mais pour que sa puissance virtuelle puisse s'exercer pleinement sur un homme, et l'aider à accomplir sa destinée, il
faut qu'il ait au préalable reçu une éducation et une
instruction lui permettant d'entrer en contact intime avec elle.
Usant du langage contemporain, on pourrait s'avancer à dire que l'Âme a une
fonction d'interface entre l'Esprit de l'Homme et les Principes
fondamentaux régissant la création. Plus simplement on observe
que le fait d'être persuadé que l'on a une Âme (l'animus
d'Aristote) renforce la force vitale qui nous aide à surmonter
les obstacles terrestres auxquels chacun de nous se heurte
Il importe enfin de souligner que, pour pouvoir remplir son rôle
quotidien, l'Âme se nourrit de la Vérité. Vérité qui permet de
discerner le Bien du Mal, le Juste de l'Inique et même le
Légitime du Légal.
![]() Littré
(Dictionnaire) : Âme - Principe de vie... L'ensemble des
facultés mentales et intellectuelles. L'aliment de l'âme, c'est
la vérité et la justice.
Littré
(Dictionnaire) : Âme - Principe de vie... L'ensemble des
facultés mentales et intellectuelles. L'aliment de l'âme, c'est
la vérité et la justice.
![]() Cuvillier
(Vocabulaire philosophique) :
Âme - Principe de la vie et de la pensée ; selon Aristote ,
les végétaux ont une âme nutritive, les animaux ont de plus une
âme sensitive et une âme motrice, l'homme seul possède une âme
pensante.
Cuvillier
(Vocabulaire philosophique) :
Âme - Principe de la vie et de la pensée ; selon Aristote ,
les végétaux ont une âme nutritive, les animaux ont de plus une
âme sensitive et une âme motrice, l'homme seul possède une âme
pensante.
![]() Code
du Cambodge ancien (IIIe partie). Art. 2 : Les bœufs,
les buffles, les éléphants et les chevaux sont des bêtes qui ont
une âme ; mais il est vrai qu'ils ne sont pas capables de
connaître comme les hommes, ce qui est juste et ce qui est
injuste.
Code
du Cambodge ancien (IIIe partie). Art. 2 : Les bœufs,
les buffles, les éléphants et les chevaux sont des bêtes qui ont
une âme ; mais il est vrai qu'ils ne sont pas capables de
connaître comme les hommes, ce qui est juste et ce qui est
injuste.
![]() Confucius
(La Grande Étude) : Les connaissances morales étant parvenues
à leur dernier degré de perfection, les intentions sont ensuite
rendues pures et sincères ; les intentions étant rendues pures
et sincères, l'âme se pénètre ensuite de probité et de droiture
; l'âme étant pénétrée de probité et de droiture, la personne
est ensuite corrigée et améliorée ; la personne étant corrigée
et améliorée, la famille est ensuite bien dirigée ; la famille
étant bien dirigée, le royaume est ensuite bien gouverné ; le
royaume étant bien gouverné, le monde jouit ensuite de la paix
et d'une heureuse harmonie...
Confucius
(La Grande Étude) : Les connaissances morales étant parvenues
à leur dernier degré de perfection, les intentions sont ensuite
rendues pures et sincères ; les intentions étant rendues pures
et sincères, l'âme se pénètre ensuite de probité et de droiture
; l'âme étant pénétrée de probité et de droiture, la personne
est ensuite corrigée et améliorée ; la personne étant corrigée
et améliorée, la famille est ensuite bien dirigée ; la famille
étant bien dirigée, le royaume est ensuite bien gouverné ; le
royaume étant bien gouverné, le monde jouit ensuite de la paix
et d'une heureuse harmonie...
Celui qui ne fait que boire et manger est un objet de mépris
parce qu'il s'occupe de la partie la moins importante de
lui-même, au détriment de la plus importante : l'âme.
![]() Aristote
(La rhétorique) : La justice, le courage, la tempérance, la
magnanimité, la magnificence et les autres dispositions morales
sont de même nature ; car elles sont autant de vertus de l'âme.
Aristote
(La rhétorique) : La justice, le courage, la tempérance, la
magnanimité, la magnificence et les autres dispositions morales
sont de même nature ; car elles sont autant de vertus de l'âme.
![]() Cicéron
(Traité des lois) : En nulle autre matière on ne peut de plus
belle façon étaler tous les dons que l'homme a reçus de la
nature, montrer quelle foule d'excellentes choses renferme l'âme
humaine, quels offices, quelles fonctions nous sommes de
naissance tenus de remplir, les liens qui nous unissent aux
autres hommes et la société naturelle qu'ils forment.
Cicéron
(Traité des lois) : En nulle autre matière on ne peut de plus
belle façon étaler tous les dons que l'homme a reçus de la
nature, montrer quelle foule d'excellentes choses renferme l'âme
humaine, quels offices, quelles fonctions nous sommes de
naissance tenus de remplir, les liens qui nous unissent aux
autres hommes et la société naturelle qu'ils forment.
Une fois ces principes posés, on trouvera facilement la source
des lois et du droit.
![]() Caro
(Problèmes de morale) : La justice, le devoir, le droit, la
distinction même du bien et du mal, toutes ces idées sublimes et
sacrées sont appelées du fond du sanctuaire de l'âme où elles
résident depuis les premiers jours de l'humanité pensante.
Caro
(Problèmes de morale) : La justice, le devoir, le droit, la
distinction même du bien et du mal, toutes ces idées sublimes et
sacrées sont appelées du fond du sanctuaire de l'âme où elles
résident depuis les premiers jours de l'humanité pensante.
![]() Simone
Weil, la philosophe catholique, pas la politicienne
(L'enracinement , éd. Paris 2014) : L'âme humaine a
besoin de vérité et de liberté d'expression. Le besoin de vérité
exige que tous aient accès à la culture de l'esprit ... Il exige
que ne s'exerce jamais dans le domaine de la pensée aucune
pression matérielle ou morale procédant d'un souci autre que le
souci exclusif de la vérité.
Simone
Weil, la philosophe catholique, pas la politicienne
(L'enracinement , éd. Paris 2014) : L'âme humaine a
besoin de vérité et de liberté d'expression. Le besoin de vérité
exige que tous aient accès à la culture de l'esprit ... Il exige
que ne s'exerce jamais dans le domaine de la pensée aucune
pression matérielle ou morale procédant d'un souci autre que le
souci exclusif de la vérité.
![]() Tom
Clancy (« Octobre rouge
»), cet auteur a acquis une grande
réputation de sérieux pour l'ensemble de sa documentation :
Dès sa prime jeunesse, Ramius avait senti, plus qu'il n'avait
su, que le communisme soviétique négligeait une aspiration
essentielle de l'être humain. Adolescent, il avait instauré une
certaine cohérence dans ses impressions. Le bien du Peuple
constituait un objectif assez louable, mais, en niant
l'existence de l'âme comme élément permanent de la personne
humaine, le marxisme détruisait les fondements de la dignité de
la valeur humaine et de la valeur individuelle. Il écartait
également la mesure objective de la justice et de la morale.
[ À mon premier voyage en Russie, j'ai été stupéfait de
voir le nombre de personnes se signant devant une église ; quand elles
n'y entraient pas le temps d'une courte prière ]
Tom
Clancy (« Octobre rouge
»), cet auteur a acquis une grande
réputation de sérieux pour l'ensemble de sa documentation :
Dès sa prime jeunesse, Ramius avait senti, plus qu'il n'avait
su, que le communisme soviétique négligeait une aspiration
essentielle de l'être humain. Adolescent, il avait instauré une
certaine cohérence dans ses impressions. Le bien du Peuple
constituait un objectif assez louable, mais, en niant
l'existence de l'âme comme élément permanent de la personne
humaine, le marxisme détruisait les fondements de la dignité de
la valeur humaine et de la valeur individuelle. Il écartait
également la mesure objective de la justice et de la morale.
[ À mon premier voyage en Russie, j'ai été stupéfait de
voir le nombre de personnes se signant devant une église ; quand elles
n'y entraient pas le temps d'une courte prière ]
- Science juridique. Par suite de son caractère immatériel, et accessoirement en raison de sa connotation religieuse dans un État laïc, l'âme ne saurait être considérée comme un Intérêt juridique* protégé par les législations nationales (même si certains ont proposé de voir, chez l'homme, le siège de l'Âme dans la glande pinéale). Toutefois le législateur peut y faire référence, implicitement ou explicitement, directement ou indirectement, tant en droit pénal qu'en procédure pénale.
En ce qui concerne les règles de fond, deux directions se présentent. L'une vise à empêcher qu'un individu ne soit privé d'une éducation morale l'initiant au Bien* et au Mal* ou ne brise les liens ainsi établis entre son Esprit* et son Âme (on pense en particulier au délit d'incitation de mineur à la débauche). L'autre tend à rétablir et à enrichir les liens existant entre l'Esprit* d'une personne, provisoirement égarée, et son Âme (on songe ici aux sanctions pénales régénératrices).
![]() Code
de droit canon. Can. 1153 : Si l’un des conjoints met en
grave danger l’âme ou le corps de l’autre ou des enfants... il
donne à l’autre un motif légitime de se séparer en vertu d’un
décret de l’Ordinaire du lieu.
Code
de droit canon. Can. 1153 : Si l’un des conjoints met en
grave danger l’âme ou le corps de l’autre ou des enfants... il
donne à l’autre un motif légitime de se séparer en vertu d’un
décret de l’Ordinaire du lieu.
![]() Code
pénal italien du 1930. Art. 530 : Encourt la réclusion de six
mois à trois ans celui qui incite une personne mineure de seize
ans à commettre des actes de débauche sur soi-même, sur la
personne du coupable, ou sur d'autres personnes.
Code
pénal italien du 1930. Art. 530 : Encourt la réclusion de six
mois à trois ans celui qui incite une personne mineure de seize
ans à commettre des actes de débauche sur soi-même, sur la
personne du coupable, ou sur d'autres personnes.
![]() Code
pénal de Bolivie. Art. 249 3° : Encourt la privation de
liberté de six mois à deux ans, le père, le tuteur, curateur,
d’un mineur, et sera en outre déclaré incapable d’exercer
l'autorité parentale, celui qui ... 2.°/ permet à ce mineur de
hanter des maisons de jeu ou de mauvaise renommée ou de
fréquenter une personne de mauvaise vie ou adonnée au vice ;
3°/ permet à ce mineur d'assister à des spectacles susceptibles
de le pervertir, ou qui offensent la pudeur, ou de prendre part
à des spectacles de semblable nature.
Code
pénal de Bolivie. Art. 249 3° : Encourt la privation de
liberté de six mois à deux ans, le père, le tuteur, curateur,
d’un mineur, et sera en outre déclaré incapable d’exercer
l'autorité parentale, celui qui ... 2.°/ permet à ce mineur de
hanter des maisons de jeu ou de mauvaise renommée ou de
fréquenter une personne de mauvaise vie ou adonnée au vice ;
3°/ permet à ce mineur d'assister à des spectacles susceptibles
de le pervertir, ou qui offensent la pudeur, ou de prendre part
à des spectacles de semblable nature.
![]() Saleilles (Les
nouvelles Écoles de droit pénal) : Le christianisme veut une
expiation qui guérisse et qui relève ; non pas celle qui
flétrit, mais celle qui réforme et qui, dans l'âme corrompue et
dégradée, refait une âme nouvelle.
Saleilles (Les
nouvelles Écoles de droit pénal) : Le christianisme veut une
expiation qui guérisse et qui relève ; non pas celle qui
flétrit, mais celle qui réforme et qui, dans l'âme corrompue et
dégradée, refait une âme nouvelle.
![]() Code
de procédure pénale du Nigeria. Art. 367 al.2 : Le
prononcé de la peine de mort sera énoncé sous la forme suivante
:
Code
de procédure pénale du Nigeria. Art. 367 al.2 : Le
prononcé de la peine de mort sera énoncé sous la forme suivante
:
« La décision de la Cour
vous concernant est que vous soyez pendu par le cou, jusqu'à ce
que mort s'ensuive ; puisse le Seigneur avoir pitié de votre âme
».
![]() Pau
7 juin 1999 (JCP 1999 IV 3111) justifie en ces termes le refus
opposé à une demande d'adoption : La femme a été condamnée à
deux ans de prison ferme et cinq ans d'interdiction des droits
civils, civiques et de famille pour proxénétisme aggravé et abus
de confiance dans des conditions et un contexte où apparaissent
sa cupidité et son ascendant sur des personnes psychologiquement
faibles ou influençables, sa domination morale, son
intelligence, sa perversité.
Pau
7 juin 1999 (JCP 1999 IV 3111) justifie en ces termes le refus
opposé à une demande d'adoption : La femme a été condamnée à
deux ans de prison ferme et cinq ans d'interdiction des droits
civils, civiques et de famille pour proxénétisme aggravé et abus
de confiance dans des conditions et un contexte où apparaissent
sa cupidité et son ascendant sur des personnes psychologiquement
faibles ou influençables, sa domination morale, son
intelligence, sa perversité.
En ce qui concerne les règles de forme, on pense surtout à la formule traditionnelle du serment le plus solennel : « Je jure en mon âme et conscience ».
![]() Pierrot
(Dictionnaire de théologie). V° Serment : La loi ne
prescrit aucune formule pour le serment en matière civile.
Chacun peut le prêter selon la manière de sa religion : le juif
"more judaico" ; les quakers, par une simple affirmation sur
leur "âme et conscience".
Pierrot
(Dictionnaire de théologie). V° Serment : La loi ne
prescrit aucune formule pour le serment en matière civile.
Chacun peut le prêter selon la manière de sa religion : le juif
"more judaico" ; les quakers, par une simple affirmation sur
leur "âme et conscience".
![]() Code
de procédure pénale du Togo. Art. 472 : Avant d’entrer
en fonction les assesseurs qui débutent leur premier mandat
prêtent serment devant la Cour d’Appel de bien et fidèlement
remplir leurs fonctions de juger en leur âme et conscience.
Code
de procédure pénale du Togo. Art. 472 : Avant d’entrer
en fonction les assesseurs qui débutent leur premier mandat
prêtent serment devant la Cour d’Appel de bien et fidèlement
remplir leurs fonctions de juger en leur âme et conscience.
- Droit positif français. On connaît cette boutade de Voltaire: « Dieu à créé l'homme à son image ; et l'homme le lui a bien rendu ! ». Les promoteurs de la Révolution l'ont concrétisée dans le Droit positif. Sortant manifestement de son domaine rationnel, en 1789 l'Assemblée nationale a mis la France sous la tutelle de la « Déesse Raison » ; puis la Conventions la placée sous l'égide de « l'Être suprême », elle toutefois affirmé sa conviction de l'existence de l'Âme. Les Révolutionnaires savaient parfaitement que le peuple a besoin de croire en un Dieu et en une Âme immortelle ; mais ce substitut purement artificiel du culte catholique n'a pu y pourvoir. Il n'est pas sans intérêt d'observer que les deux textes suivants semblent n'avoir jamais été abrogés, et que, par suite, l'État confesse une forme de religion autonome (ce qui atténue grandement son prétendu caractère laïc).
![]() Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, Préambule :
L'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence de
l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen...
Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, Préambule :
L'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence de
l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen...
![]() Décret de la Convention
du 18 floréal an II :
Le Peuple français reconnaît l'Être suprême et l'immortalité de
l'Âme.
Décret de la Convention
du 18 floréal an II :
Le Peuple français reconnaît l'Être suprême et l'immortalité de
l'Âme.
Quant à eux, les Révolutionnaires y croyaient si peu que,
lorsque Talleyrand monta à l'autel célébrer le premier culte, il
souffla à son assesseur : «
Surtout, ne me faites pas rire !
». Mais leur « religion
civile » n'en a pas moins subsisté sous la Commune, en l'U. R.
S. S. puis chez ses avatars. Elle se perpétue de nos jours : le
Drapeau français n'a-t-il pas été modifié, en ce qui
concerne le sigle de L'État ? Le Blanc des Rois, qui ont fait la
France, a été remplacée par le profil d'une Marianne, symbole
maçonnique au demeurant plus athée que religieux.
Le Code pénal de 1993 incrimine encore la provocation délibérée
d'un mineur à la débauche.
![]() Cass.crim.
17 octobre 1956 (Gaz.Pal. TQ. 1956-1960, v° Attentat aux moeurs
n° 17) : Caractérise le délit l'arrêt qui constate que
le prévenu a incité des enfants, mineurs de 12 ans, à se livrer
entre eux aux gestes et attitudes d'un rapprochement obscène et
que donnant suite à cette invitation, accompagnée de la
part du prévenu de conseils et de promesses d'argent, les
enfants se livrèrent entre eux au simulacre d'un rapprochement
sexuel.
Cass.crim.
17 octobre 1956 (Gaz.Pal. TQ. 1956-1960, v° Attentat aux moeurs
n° 17) : Caractérise le délit l'arrêt qui constate que
le prévenu a incité des enfants, mineurs de 12 ans, à se livrer
entre eux aux gestes et attitudes d'un rapprochement obscène et
que donnant suite à cette invitation, accompagnée de la
part du prévenu de conseils et de promesses d'argent, les
enfants se livrèrent entre eux au simulacre d'un rapprochement
sexuel.
![]() Cass.crim.
14 novembre 1990 (Droit pénal 1991 105) : L'excitation
de mineurs à la débauche n'est pénalement punissable que si
l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse.
Cass.crim.
14 novembre 1990 (Droit pénal 1991 105) : L'excitation
de mineurs à la débauche n'est pénalement punissable que si
l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse.
AMENDE
Cf. Assurance*, Décimes additionnels*, Fredum*, Jour amende*, Mulcter*, Peine*, Sanction*, Souscription*.
L’amende est une sanction pécuniaire infligée, par un tribunal, à une partie privée qui a commis une faute, soit dans un acte de la vie quotidienne, soit en cours de procédure (on écrivait jadis « amande »).
![]() Dictionnaire civil et canonique (Paris 1687) : Amande
vient du mot latin « emendatio », qui signifie correction. C’est pour cela que nos anciens Docteurs disaient « émende » et non
« amande » … Elle est une peine pécuniaire.
Dictionnaire civil et canonique (Paris 1687) : Amande
vient du mot latin « emendatio », qui signifie correction. C’est pour cela que nos anciens Docteurs disaient « émende » et non
« amande » … Elle est une peine pécuniaire.
![]() Jeandidier (Droit pénal général) : L’amende est une
peine consistant en un versement d’une somme d’argent par le condamné au Trésor public, dont le recouvrement est confié aux percepteurs des contributions
directes.
Jeandidier (Droit pénal général) : L’amende est une
peine consistant en un versement d’une somme d’argent par le condamné au Trésor public, dont le recouvrement est confié aux percepteurs des contributions
directes.
![]() Garnot (Histoire
de la justice) : L'amende offre de nombreux avantages :
elle présente une grande capacité d'adaptation aux
caractéristiques personnelles du condamné ; dans le cas d'erreur
judiciaire, sa réparation peur se faire de façon simple ; elle
évite l'apparition d'effets préjudiciable de caractère social à
l'égard du condamné, tels que la possibilité de perdre la
crédibilité de son entourage ou encore un processus de
désocialisation.
Garnot (Histoire
de la justice) : L'amende offre de nombreux avantages :
elle présente une grande capacité d'adaptation aux
caractéristiques personnelles du condamné ; dans le cas d'erreur
judiciaire, sa réparation peur se faire de façon simple ; elle
évite l'apparition d'effets préjudiciable de caractère social à
l'égard du condamné, tels que la possibilité de perdre la
crédibilité de son entourage ou encore un processus de
désocialisation.
Les juges ont l'habitude, quand ils prononcent une amende, de se
décider en fonction de quatre éléments, la restitution (des
biens volés, de l'honneur bafoué, du corps blessé), la
réaffirmation du droit de la partie lésés, les dommages-intérêts
et le paiement des frais de justice.
- L’amende est le plus souvent une sanction pénale qui consiste en une condamnation, prononcée contre l’auteur d’une infraction, au paiement d’une certaine somme d’argent. Son domaine d’application est rationnellement limité aux infractions les moins dangereuses ; elle ne saurait en effet suffire à réprimer des agissements graves tels que les infractions contre l’intégrité physique ou morale des personnes ; sinon il suffirait d’être fortuné pour pouvoir impunément agresser autrui.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° III-243, p.457
- principalement
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° III-243, p.457
- principalement
![]() Voir :
A. Franck, De la peine en général
Voir :
A. Franck, De la peine en général
![]() Trousse (Novelles de droit pénal belge) :
L’amende est une peine pécuniaire qui consiste dans l’obligation de payer une certaine somme au profit de l’État.
Trousse (Novelles de droit pénal belge) :
L’amende est une peine pécuniaire qui consiste dans l’obligation de payer une certaine somme au profit de l’État.
![]() Bautain (Philosophie des lois) : Si vous êtes condamné
à l'amende, vous êtes tenu en conscience de la payer ; car il y a un jugement, et ainsi la loi devient indirectement préceptive.
Bautain (Philosophie des lois) : Si vous êtes condamné
à l'amende, vous êtes tenu en conscience de la payer ; car il y a un jugement, et ainsi la loi devient indirectement préceptive.
![]() Cass.crim. 16 janvier 1947 (Bull.crim. n° 24
p.33) : Doit être annulée la décision qui inflige à un prévenu une amende supérieure au maximum prévu par la loi applicable au moment où les
faits ont été commis.
Cass.crim. 16 janvier 1947 (Bull.crim. n° 24
p.33) : Doit être annulée la décision qui inflige à un prévenu une amende supérieure au maximum prévu par la loi applicable au moment où les
faits ont été commis.
Si l'amende prévue par le législateur se situe à un niveau trop bas, elle ne produit pas d'effet dissuasif et ne remplit dès lors pas son office.
![]() Denisart (Collection de jurisprudence,
1768) : Jusqu’au temps de Charlemagne, la plupart des crimes n’étaient punis que par des peines pécuniaires, qui étaient si médiocres qu’on était
quitte de la mort d’un évêque pour 900 sous.
Denisart (Collection de jurisprudence,
1768) : Jusqu’au temps de Charlemagne, la plupart des crimes n’étaient punis que par des peines pécuniaires, qui étaient si médiocres qu’on était
quitte de la mort d’un évêque pour 900 sous.
![]() Proal (Le crime et la peine) : Si l'homme riche
pouvait souffleter, diffamer ou commettre tout autre délit, en n'exposant que sa bourse, on verrait aussitôt se reproduire les abus qui existaient à
Rome. Aulu-Gelle raconte que le plaisir de Lucius Veratius était d'appliquer la paume de la main sur la joue d'un homme libre. Un esclave le suivait, une
bourse pleine d'or à la main, et à mesure que le maître avait donné un soufflet, l'esclave, selon la prescription de la loi, comptait 25 as.
Proal (Le crime et la peine) : Si l'homme riche
pouvait souffleter, diffamer ou commettre tout autre délit, en n'exposant que sa bourse, on verrait aussitôt se reproduire les abus qui existaient à
Rome. Aulu-Gelle raconte que le plaisir de Lucius Veratius était d'appliquer la paume de la main sur la joue d'un homme libre. Un esclave le suivait, une
bourse pleine d'or à la main, et à mesure que le maître avait donné un soufflet, l'esclave, selon la prescription de la loi, comptait 25 as.
![]() Laget-Valdeson (Théorie
du Code Espagnol de 1850, éd. 1860) : Le châtiment
pécuniaire est le plus inégal qui se puisse concevoir ; lorsque,
identique dans son expression, il touche deux personnes d'une
fortune différente.
Laget-Valdeson (Théorie
du Code Espagnol de 1850, éd. 1860) : Le châtiment
pécuniaire est le plus inégal qui se puisse concevoir ; lorsque,
identique dans son expression, il touche deux personnes d'une
fortune différente.
L'amende peut être fixe, variable entre un minimum et un maximum, ou encore proportionnelle soit aux frais engagés soit au gain obtenu soit au dommage causé.
![]() Loi du 2 juin 1891 sur les courses de chevaux. Art. 4
al. 4 : Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris de courses de chevaux visés au présent article
est puni de 100.000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à
l'opération illégale.
Loi du 2 juin 1891 sur les courses de chevaux. Art. 4
al. 4 : Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris de courses de chevaux visés au présent article
est puni de 100.000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à
l'opération illégale.
![]() Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel, n° 662) :
Souvent l'amende est prévue par la loi comme une peine proportionnelle, soit au bénéfice réalisée par l'argent, soit au préjudice qu'i a causé. Si le
législateur s'était contenté de permettre aux juges de faire varier la peine entre un maximum et un minimum le montant de l'amende risquerait de n'être
pas assez élevé. C'est pourquoi il faut se féliciter de ce que le législateur a institué des amendes proportionnelles.
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel, n° 662) :
Souvent l'amende est prévue par la loi comme une peine proportionnelle, soit au bénéfice réalisée par l'argent, soit au préjudice qu'i a causé. Si le
législateur s'était contenté de permettre aux juges de faire varier la peine entre un maximum et un minimum le montant de l'amende risquerait de n'être
pas assez élevé. C'est pourquoi il faut se féliciter de ce que le législateur a institué des amendes proportionnelles.
On a observé que dans le Code pénal de 1993 le chiffre le plus employé, tant pour la peine d'emprisonnement que pour la peine d'amende, est le chiffre 7 ; le chiffre de la Déesse Raison.
![]() Alland
et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Nombres du
droit, par P.-Y. Gautier : La sécurité juridique, le
confort des citoyens dans l'usage du droit, constitue un
objectif fondamental. Peut-être peuvent-ils contribuer à son
épanouissement. Ainsi, sept apparaît comme le chiffre
de la raison...
Alland
et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Nombres du
droit, par P.-Y. Gautier : La sécurité juridique, le
confort des citoyens dans l'usage du droit, constitue un
objectif fondamental. Peut-être peuvent-ils contribuer à son
épanouissement. Ainsi, sept apparaît comme le chiffre
de la raison...
En principe les amendes sont strictement personnelles ; mais le législateur admet la solidarité du paiement des amendes dans certains cas exceptionnels.
En toute hypothèse l'amende pénale est d'ordre public, en sorte
qu'elle ne saurait être couverte par une Assurance*
ou une Souscription*.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-I-315,
p.289
Voir :
Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-I-315,
p.289
![]() Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : La
solidarité au paiement des amendes est une atteinte incontestable au principe de la personnalité des peines. Aussi deux conditions spécifiques sont-elles
exigées ... D'une part, elle n'est possible que si l'intéressé s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables" ... D'autre part, la juridiction
doit l'avoir ordonnée par une décision spéciale et motivée.
Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : La
solidarité au paiement des amendes est une atteinte incontestable au principe de la personnalité des peines. Aussi deux conditions spécifiques sont-elles
exigées ... D'une part, elle n'est possible que si l'intéressé s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables" ... D'autre part, la juridiction
doit l'avoir ordonnée par une décision spéciale et motivée.
- Il existe également des amendes civiles, qui seraient mieux nommées amendes procédurales. Ainsi notre Ancien
droit connaissait une amende de « fol appel », infligée à celui qui avait usé de cette voie de recours « témérairement, sans cause et sans
fondement ». De même notre Code de procédure pénale imposait à celui qui formait un pourvoi en cassation de consigner l’amende à laquelle il serait
condamné en cas de rejet. Mais il est apparu que le principe du libre accès à la justice s’oppose normalement à ce que soit déclaré délictueux le simple
fait d’exercer une action en justice.
Il n’en demeure pas moins, de nos jours, que l’Abus de constitution de partie civile*,
et plus généralement l'Abus de droit*, est sanctionné, non seulement par
des dommages-intérêts, mais encore par une amende civile (art. 177-2 C.pr.pén.).
Pour prendre un second exemple, l'article 192 du Code civil
punit d'une amende de quelques euros le fait pour un officier
d'état civil de célébrer un mariage qui n'a pas été
précédé de la publication des bans.
![]() Code civil, art. 10
(loi du 5 juillet 1972) : Chacun est tenu d’apporter
son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Code civil, art. 10
(loi du 5 juillet 1972) : Chacun est tenu d’apporter
son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à
peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
![]() Cass.crim. 27 février 2002 (Bull.crim. n° 47
p.133) : Le prononcé d’une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire n’entre pas dans les prévisions de l’art. 6.1 de
la Convention européenne des droits de l’homme.
Cass.crim. 27 février 2002 (Bull.crim. n° 47
p.133) : Le prononcé d’une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire n’entre pas dans les prévisions de l’art. 6.1 de
la Convention européenne des droits de l’homme.
Le juge d’instruction n’est pas tenu de motiver spécialement le montant de l’amende civile prononcée en application de l’art. 177-2 C.pr.pén. issu de
la loi du 15 juin 2000.
Notons que, dans certains cas où le législateur pénal a édicté
pour des agissements graves des amendes insuffisantes, les juges
prononcent parfois des dommages-intérêts calculés, non sur le
préjudice subi par la victime, mais sur le gain fait ou escompté
par le coupable. On se trouve alors en présence d'une amende
civile judiciaire, fondée en morale si elle ne l'est pas en
droit strict (voir : Mensonge*,
exemple).
Par ailleurs, le prononcé d'une amende civile n'interdit pas de
prononcer une amende pénale, dès lors que deux intérêts
juridiques distincts ont été lésés.
![]() Cass.crim.
22 septembre 2015, pourvoi n° 14-84029 : La demanderesse
ne saurait soutenir que, en application de la règle non bis in
idem prévue à l'art. 4 du protocole n° 7 additionnel à la Conv.
EDH, le prononcé d'une amende civile exclut celui d'une sanction
pour dénonciation calomnieuse, dès lors que les intérêts
protégés respectivement par les articles 177-2 C.pr.pén. et
226-10 C.pén. sont distincts, le premier sanctionnant une
atteinte à une bonne administration de la justice tandis que le
second réprime un comportement destiné à nuire à autrui.
Cass.crim.
22 septembre 2015, pourvoi n° 14-84029 : La demanderesse
ne saurait soutenir que, en application de la règle non bis in
idem prévue à l'art. 4 du protocole n° 7 additionnel à la Conv.
EDH, le prononcé d'une amende civile exclut celui d'une sanction
pour dénonciation calomnieuse, dès lors que les intérêts
protégés respectivement par les articles 177-2 C.pr.pén. et
226-10 C.pén. sont distincts, le premier sanctionnant une
atteinte à une bonne administration de la justice tandis que le
second réprime un comportement destiné à nuire à autrui.
- On rencontre enfin des amendes administratives qui présentent la particularité d'être mixtes, pour partie pénales et pour partie civiles. Il en résulte un régime autonome, qui se manifeste notamment par le fait que le principe du non-cumul des peines ne les concerne pas.
![]() Cass.crim.
24 février 1999 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. p.74) : Pour
fixer le montant de l'amende douanière encourue par le prévenu
au titre de l'art. 414 C. douanes, les juges du fond, après
avoir rappelé les quantités de stupéfiants sur lesquelles le
trafic avait porté et les prix de cession pratiqués, énoncent
que la valeur de la marchandise de fraude retenue par
l'Administration, 1.074.800 F, était fondée dans son montant et
qu'elle pouvait servir de base au calcul de l'amende.
Cass.crim.
24 février 1999 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. p.74) : Pour
fixer le montant de l'amende douanière encourue par le prévenu
au titre de l'art. 414 C. douanes, les juges du fond, après
avoir rappelé les quantités de stupéfiants sur lesquelles le
trafic avait porté et les prix de cession pratiqués, énoncent
que la valeur de la marchandise de fraude retenue par
l'Administration, 1.074.800 F, était fondée dans son montant et
qu'elle pouvait servir de base au calcul de l'amende.
En prononçant ainsi, et dès lors que, pour fixer le montant de
l'amende prévue à l'art. 414 C. douanes, lorsque les faits de
contrebande portent sur des stupéfiants, les juges du fond
tirent des dispositions de l'art. 438 dudit Code le droit de se
référer à la valeur de ces produits sur les marchés clandestins
dont ils font l'objet, la Cour d'appel a justifié sa décision.
![]() Cass.crim.
27 juin 2012, n° 11-86679 (Gaz.Pal. 30 août 2012 p.25) :
Les amendes douanières échappent, en raison de leur caractère
mixte, répressif et indemnitaire, à la règle du non-cumul des
peines.
Cass.crim.
27 juin 2012, n° 11-86679 (Gaz.Pal. 30 août 2012 p.25) :
Les amendes douanières échappent, en raison de leur caractère
mixte, répressif et indemnitaire, à la règle du non-cumul des
peines.
![]() Cass.crim.
19 février 2003, (Bull.crim. n° 43 p.164) : L'amende
douanière, à laquelle a été condamné le préposé, en raison de
son caractère partiellement indemnitaire, peut être mise à la
charge du civilement responsable.
Cass.crim.
19 février 2003, (Bull.crim. n° 43 p.164) : L'amende
douanière, à laquelle a été condamné le préposé, en raison de
son caractère partiellement indemnitaire, peut être mise à la
charge du civilement responsable.
![]() Cass.crim.
29 octobre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 40) : Chaque
infraction douanière doit donner lieu à l'application d'une
amende fiscale distincte dont seuls leurs auteurs respectifs
ont à répondre vis-à-vis de l'Administrations.
Cass.crim.
29 octobre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 40) : Chaque
infraction douanière doit donner lieu à l'application d'une
amende fiscale distincte dont seuls leurs auteurs respectifs
ont à répondre vis-à-vis de l'Administrations.
![]() Cass.crim.
25 novembre 1992 (Gaz.Pal. 1993 I Chr. 233) : Les
amendes forestières qui, participant à la fois de la peine
et de la réparation civile, ont un caractère mixte, ne peuvent
être suspendues par l’effet du sursis.
Cass.crim.
25 novembre 1992 (Gaz.Pal. 1993 I Chr. 233) : Les
amendes forestières qui, participant à la fois de la peine
et de la réparation civile, ont un caractère mixte, ne peuvent
être suspendues par l’effet du sursis.
AMENDE HONORABLE
Cf. Autocritique*, Cangue*, Palinodie*, Pilori*, Publicité de la peine*, Repentir*, Sanction*.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° III-219, p.432
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° III-219, p.432
![]() Voir :
Affaire Truche de la Chaux.
Voir :
Affaire Truche de la Chaux.
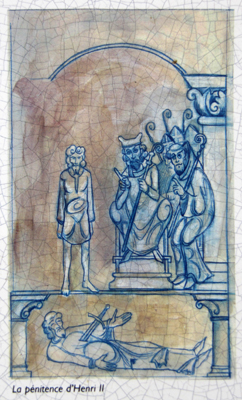 L’amende honorable est une déclaration solennelle, par laquelle un délinquant reconnaît sa faute et en demande pardon tant à la victime qu’à la société.
Cette peine, de caractère infamant, a été abolie par le Code pénal de 1791.
L’amende honorable est une déclaration solennelle, par laquelle un délinquant reconnaît sa faute et en demande pardon tant à la victime qu’à la société.
Cette peine, de caractère infamant, a été abolie par le Code pénal de 1791.
![]() De Ferrière (Dictionnaire de droit) :
L’amende honorable est une peine infamante… le coupable est
condamné à dire qu’il a faussement dit ou fait quelque chose
contre l’autorité du Roi ou contre l’honneur de quelqu’un, et
qu’il en requiert pardon à Dieu, au Roi, à la Justice et à la
Partie offensée.
De Ferrière (Dictionnaire de droit) :
L’amende honorable est une peine infamante… le coupable est
condamné à dire qu’il a faussement dit ou fait quelque chose
contre l’autorité du Roi ou contre l’honneur de quelqu’un, et
qu’il en requiert pardon à Dieu, au Roi, à la Justice et à la
Partie offensée.
![]() Muyart
de Vouglans, « Instruction criminelle » (Paris 1752), p.807
donne cet exemple : Nous avons ledit .°.°. déclaré dûment
atteint et convaincu des Cas mentionnés au procès ; pour
réparation de quoi, le condamnons à faire Amende honorable, nud
en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une Torche de
cire ardente, du poids de deux livres, l'Audience tenante ; et
là, étant nue tête, et à genoux, dire et déclarer à haute et
intelligible voix, que méchamment et comme mal avisé il a . . .
dont il se repend, et en demande pardon à Dieu, au Roi et à la
Justice ; le condamnons en outre en . . . livres de réparations
civiles, dommages et intérêts envers . . . , en . . . livres
d'amende envers le Roi, et aux dépens du Procès.
Muyart
de Vouglans, « Instruction criminelle » (Paris 1752), p.807
donne cet exemple : Nous avons ledit .°.°. déclaré dûment
atteint et convaincu des Cas mentionnés au procès ; pour
réparation de quoi, le condamnons à faire Amende honorable, nud
en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une Torche de
cire ardente, du poids de deux livres, l'Audience tenante ; et
là, étant nue tête, et à genoux, dire et déclarer à haute et
intelligible voix, que méchamment et comme mal avisé il a . . .
dont il se repend, et en demande pardon à Dieu, au Roi et à la
Justice ; le condamnons en outre en . . . livres de réparations
civiles, dommages et intérêts envers . . . , en . . . livres
d'amende envers le Roi, et aux dépens du Procès.
![]() Toureille
(Crime et châtiment au Moyen-âge) : L'amende honorable
consiste à conduire le coupable devant la maison de sa victime
ou sur le lieu du forfait, parfois encore devant l'église. Il
s'agenouille nu-tête, en chemise, tenant à la main une torche ou
un flambeau dont le poids est proportionnel à la gravité de son
crime. Il demande « pardon à
Dieu, au roi et à la justice »,
puis présente ses excuses à la victime ou à sa famille.
Toureille
(Crime et châtiment au Moyen-âge) : L'amende honorable
consiste à conduire le coupable devant la maison de sa victime
ou sur le lieu du forfait, parfois encore devant l'église. Il
s'agenouille nu-tête, en chemise, tenant à la main une torche ou
un flambeau dont le poids est proportionnel à la gravité de son
crime. Il demande « pardon à
Dieu, au roi et à la justice »,
puis présente ses excuses à la victime ou à sa famille.
![]() Ortolan (Éléments de droit pénal) : L’amende honorable
consiste en des rétractations, abjurations, demandes de pardon, ou autres semblables déclarations … faite avec des signes d’humiliation.
Ortolan (Éléments de droit pénal) : L’amende honorable
consiste en des rétractations, abjurations, demandes de pardon, ou autres semblables déclarations … faite avec des signes d’humiliation.
![]() Pallegoix (Description du royaume Thaï) : Il y
a une autre peine infamante, appelée Ta-ven, voici en quoi elle consiste : le criminel portant les fers aux pieds, et la cangue au cou, est promené par
toute la ville au son d'une cymbale avec un cortège de satellites armés ; à chaque fois qu'on bat de la cymbale, le coupable est obligé de crier à haute
voix : J'ai commis tel crime, n'imitez pas mon exemple !
Pallegoix (Description du royaume Thaï) : Il y
a une autre peine infamante, appelée Ta-ven, voici en quoi elle consiste : le criminel portant les fers aux pieds, et la cangue au cou, est promené par
toute la ville au son d'une cymbale avec un cortège de satellites armés ; à chaque fois qu'on bat de la cymbale, le coupable est obligé de crier à haute
voix : J'ai commis tel crime, n'imitez pas mon exemple !
AMENDEMENT
Cf. Doctrines criminelles*, Expiation*, Intimidation*, Mesure de sûreté*, Mutilation (à titre de peine)*, Peine*, Prévention*, Remords*, Réinsertion*, Repentir*, Rétribution*, Sanction*.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-9, p.365
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-9, p.365
![]() Voir :
G. Levasseur - Politique criminelle :
Peines ou mesures de sûreté ?
Voir :
G. Levasseur - Politique criminelle :
Peines ou mesures de sûreté ?
Amender un terrain, c’est lui incorporer des éléments afin de le rendre plus apte à fournir de bons produits ; amender un délinquant, c’est lui donner les moyens de trouver ou de retrouver le chemin du bien. Dans le même sens on parle également de resocialisation, de réinsertion, de réadaptation ou de reclassement. L’idée directrice demeure toujours que la peine ne doit pas tendre seulement à l’intimidation, à la prévention et à l’expiation, mais également au renouveau du condamné, à sa régénération morale.
- Règle morale. Pour les moralistes, la peine doit tendre en premier lieu à régénérer le coupable.
![]() Pufendorf (Le droit de la nature, éd. 1734) : Les
peines ... doivent tendre à corriger le coupable et à lui faire perdre l'envie de retomber dans le crime, en usant envers lui d'un remède qui guérisse le
mal par son contraire.
Pufendorf (Le droit de la nature, éd. 1734) : Les
peines ... doivent tendre à corriger le coupable et à lui faire perdre l'envie de retomber dans le crime, en usant envers lui d'un remède qui guérisse le
mal par son contraire.
![]() Ahrens (Cours de droit naturel) : Le but de la
peine doit être de remettre le coupable, par l’amendement, dans le plein exercice de ses droits ... La théorie de l’amendement ne poursuit pas une
expiation mystique, mais la vraie expiation, par le repentir, par une réforme, souvent lente et pénible, de toute la conduite du coupable.
Ahrens (Cours de droit naturel) : Le but de la
peine doit être de remettre le coupable, par l’amendement, dans le plein exercice de ses droits ... La théorie de l’amendement ne poursuit pas une
expiation mystique, mais la vraie expiation, par le repentir, par une réforme, souvent lente et pénible, de toute la conduite du coupable.
![]() Gousset (Théologie morale) : Le confesseur doit
imposer des pénitences salutaires ... C'est donc un devoir pour lui de sonder, au besoin, les dispositions du pénitent relativement à la pénitence qu'on
se propose de lui prescrire.
Gousset (Théologie morale) : Le confesseur doit
imposer des pénitences salutaires ... C'est donc un devoir pour lui de sonder, au besoin, les dispositions du pénitent relativement à la pénitence qu'on
se propose de lui prescrire.
![]() Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu
(2009) : Le système des pénalités vise à la réadaptation des contrevenants et la prévention des infractions.
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu
(2009) : Le système des pénalités vise à la réadaptation des contrevenants et la prévention des infractions.
- Science criminelle. Les pénalistes reconnaissent l'importance de ce but de la peine, mais ils ne sauraient négliger les autres aspects de la sanction : prévention générale et expiation.
![]() Tarde (La philosophie pénale) : L’expiation a été
la principale forme que l’utilitarisme pénal a d’abord revêtue. La forme secondaire, devenue principale plus tard, a été l’exemplarité. La dernière sera
l’amendement dans la mesure où il sera possible.
Tarde (La philosophie pénale) : L’expiation a été
la principale forme que l’utilitarisme pénal a d’abord revêtue. La forme secondaire, devenue principale plus tard, a été l’exemplarité. La dernière sera
l’amendement dans la mesure où il sera possible.
![]() Franck (Philosophie du droit pénal) : La société, en
frappant les rebelles qui outragent ses lois, n’ayant pas d’autre but que de se défendre, est amenée par ce principe même à éteindre dans le cœur de son
ennemi vaincu le germe du désordre, c’est-à-dire les passions qui en sont la source. Elle s’efforcera donc de l’amender, de le corriger, de l’instruire,
pendant tout le temps qu’elle le tient en son pouvoir. L’amendement du coupable, sans être le but principal de la loi, pourra donc venir en aide à la
pénalité, en donnant pour auxiliaire à la justice le principe de la charité.
Franck (Philosophie du droit pénal) : La société, en
frappant les rebelles qui outragent ses lois, n’ayant pas d’autre but que de se défendre, est amenée par ce principe même à éteindre dans le cœur de son
ennemi vaincu le germe du désordre, c’est-à-dire les passions qui en sont la source. Elle s’efforcera donc de l’amender, de le corriger, de l’instruire,
pendant tout le temps qu’elle le tient en son pouvoir. L’amendement du coupable, sans être le but principal de la loi, pourra donc venir en aide à la
pénalité, en donnant pour auxiliaire à la justice le principe de la charité.
On amende le coupable, non par l’adoucissement de sa peine, mais par l’amélioration de ses sentiments et de ses mœurs, par les germes de moralité et
d’instruction qu’on répand dans son cœur, par les austères habitudes qu’on introduit dans sa vie. La vraie charité n’est pas celle qui s’adresse au
corps, mais celle qui a pour but le perfectionnement des âmes.
![]() Ferri (Sociologie criminelle) : L’utilité et le
devoir de l’amendement subsistent, même pour l’école positiviste, lorsqu’il est possible, pour certaines catégories de criminels.
Ferri (Sociologie criminelle) : L’utilité et le
devoir de l’amendement subsistent, même pour l’école positiviste, lorsqu’il est possible, pour certaines catégories de criminels.
![]() Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : Il
est une fonction de la peine susceptible de concilier les théories classiques et celles fondées sur la défense sociale. Il s’agit de la fonction
d’amendement … Lardizabal, conseiller du roi d’Espagne soulignait que « l’amendement est un objectif si important que jamais le législateur ne doit
le perdre de vue ». La peine doit donc à la fois punir et soutenir.
Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : Il
est une fonction de la peine susceptible de concilier les théories classiques et celles fondées sur la défense sociale. Il s’agit de la fonction
d’amendement … Lardizabal, conseiller du roi d’Espagne soulignait que « l’amendement est un objectif si important que jamais le législateur ne doit
le perdre de vue ». La peine doit donc à la fois punir et soutenir.
![]() Jeandidier (Droit pénal général) : Le troisième but de
la peine, d’apparition récente, est l’amendement ou la réadaptation du condamné. Plus que jamais, on est présentement persuadé qu’une répression qui
ignore la nécessité impérieuse de réadapter les délinquants est contraire aux droits de l’homme. Juste et généreux, le thème de l’amendement n’en est pas
moins la plupart du temps utopique car la prison, sanction nécessaire pour les infractions les plus graves, est surtout l’école de l’avilissement.
Jeandidier (Droit pénal général) : Le troisième but de
la peine, d’apparition récente, est l’amendement ou la réadaptation du condamné. Plus que jamais, on est présentement persuadé qu’une répression qui
ignore la nécessité impérieuse de réadapter les délinquants est contraire aux droits de l’homme. Juste et généreux, le thème de l’amendement n’en est pas
moins la plupart du temps utopique car la prison, sanction nécessaire pour les infractions les plus graves, est surtout l’école de l’avilissement.
![]() Code pénal de Cuba. Art. 47 : Le tribunal
fixe la mesure de la sanction, dans les limites établies par la loi, en tenant compte … des antécédents du coupable, de son caractère propre et de ses
possibilités d'amendement.
Code pénal de Cuba. Art. 47 : Le tribunal
fixe la mesure de la sanction, dans les limites établies par la loi, en tenant compte … des antécédents du coupable, de son caractère propre et de ses
possibilités d'amendement.
![]() Code pénal du Mexique. Art. 42 :
l’admonestation consiste en un avertissement que le juge adresse à l’accusé, lui faisant voir les conséquences de l’infraction qu’il a commise,
l’invitant à l’amendement et lui faisant valoir qu’il encourra une sanction plus lourde s’il récidive.
Code pénal du Mexique. Art. 42 :
l’admonestation consiste en un avertissement que le juge adresse à l’accusé, lui faisant voir les conséquences de l’infraction qu’il a commise,
l’invitant à l’amendement et lui faisant valoir qu’il encourra une sanction plus lourde s’il récidive.
![]() Cass.crim. 5 août 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr. crim.
195) : Pour confirmer à bon droit l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la demande de mise en liberté de B..., la Chambre d’accusation
relève … que l’intéressé a été cinq fois condamné pour des faits de même nature, qu’il est sans domicile ni travail et ne présente aucune
perspective d’amendement ou de réinsertion sociale.
Cass.crim. 5 août 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr. crim.
195) : Pour confirmer à bon droit l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la demande de mise en liberté de B..., la Chambre d’accusation
relève … que l’intéressé a été cinq fois condamné pour des faits de même nature, qu’il est sans domicile ni travail et ne présente aucune
perspective d’amendement ou de réinsertion sociale.
![]() Illustration
(Presse quotidienne) : Kenya - Une française de 76 ans
qui avait été inculpée pour possession d'arme à feu a été
relaxée par le Tribunal de Mombassa... Le juge l'a acquittée, en
estimant qu'elle était trop âgée et qu'il serait vain de
l'envoyer en prison parce qu'elle n'était plus susceptible de
s'amender.
Illustration
(Presse quotidienne) : Kenya - Une française de 76 ans
qui avait été inculpée pour possession d'arme à feu a été
relaxée par le Tribunal de Mombassa... Le juge l'a acquittée, en
estimant qu'elle était trop âgée et qu'il serait vain de
l'envoyer en prison parce qu'elle n'était plus susceptible de
s'amender.
- Méthodes d'amendement. On peut envisager d'amender un délinquant, soit par des moyens physiologiques (la lobotomie, causant une atteinte physique), soit par les moyens chimiques (pharmacothérapie, causant une atteinte psychique)), soit par des moyens psychologiques. Ce sont ces derniers, les moins nocifs pour l'individu, que nous évoquerons ici : psychothérapie et béhaviorisme.
![]() Commission
de réforme du droit du Canada (Document 43, 1985) :
Les psychothérapies ont toutes en commun la création d'une
relation de type professionnel entre l'individu et le
thérapeute. Le premier va communiquer au second sans contrainte
au second ses réflexions, ses idées ses sentiments. Par et à
travers cette relation, le patient va peu à peu comprendre le
pourquoi de ses sentiments et de ses réactions en les revivant
et en les verbalisant. Il va progressivement être en mesure de
mieux comprendre son comportement. La thérapie vise donc à faire
disparaître chez lui certains états anxieux ou d'angoisse, et
lui permettre, en se connaissant mieux, de développer sa
personnalité d'une façon positive...
Commission
de réforme du droit du Canada (Document 43, 1985) :
Les psychothérapies ont toutes en commun la création d'une
relation de type professionnel entre l'individu et le
thérapeute. Le premier va communiquer au second sans contrainte
au second ses réflexions, ses idées ses sentiments. Par et à
travers cette relation, le patient va peu à peu comprendre le
pourquoi de ses sentiments et de ses réactions en les revivant
et en les verbalisant. Il va progressivement être en mesure de
mieux comprendre son comportement. La thérapie vise donc à faire
disparaître chez lui certains états anxieux ou d'angoisse, et
lui permettre, en se connaissant mieux, de développer sa
personnalité d'une façon positive...
Les théories béhavioristes sont toutes, à des degrés divers,
basées sur la notion d'apprentissage de comportement nouveaux et
de « désapprentissage » de
comportements individuels lugés négatifs.
AMENDEMENTS
Cf. Loi*, Ratio legis*, Travaux préparatoires*.
- Notion. Un amendement législatif est une modification, une adjonction, une restriction apportée, sur la suggestion d’un ou de plusieurs parlementaires, à un projet ou à une proposition de loi. Voté, il s’intègre au texte de la loi.
![]() Barthélemy (Droit constitutionnel) : Lorsqu’un texte a
été proposé, soit par un parlementaire, soit par le Gouvernement, les membres des Chambres peuvent y proposer des modifications ou des additions. Ces
propositions partielles sont les amendements.
Barthélemy (Droit constitutionnel) : Lorsqu’un texte a
été proposé, soit par un parlementaire, soit par le Gouvernement, les membres des Chambres peuvent y proposer des modifications ou des additions. Ces
propositions partielles sont les amendements.
- Avantage. Utilisé avec prudence, l’exercice du droit d’amendement peut apporter une amélioration de la loi. Au demeurant, le débat auquel un amendement donne lieu enrichit les travaux préparatoires et permet de mieux préciser la volonté du législateur.
![]() Garraud (L’anarchie) : Il a été spécifié, dans les
travaux préparatoires, qu’un seul fait de provocation ou d’apologie constituait la propagande incriminée. Cette solution est précisée par le rejet de
deux amendements : le premier, présenté par M. de Ramel, ajoutait : « réitérées » après apologies ; l’autre, du vicomte d’Hugues,
portait : « d’avoir, à maintes reprises, et dans un but déterminé de propagande anarchiste... ».
Garraud (L’anarchie) : Il a été spécifié, dans les
travaux préparatoires, qu’un seul fait de provocation ou d’apologie constituait la propagande incriminée. Cette solution est précisée par le rejet de
deux amendements : le premier, présenté par M. de Ramel, ajoutait : « réitérées » après apologies ; l’autre, du vicomte d’Hugues,
portait : « d’avoir, à maintes reprises, et dans un but déterminé de propagande anarchiste... ».
- Danger. Trop souvent proposés sans réflexion préalable et adoptés sans débat approfondi, de nombreux amendements ont un effet nocif sur la cohérence de l’ensemble du corps des lois.
![]() Aristote (Éthique de Nicomaque) : Une mauvaise
loi est celle qui est faite à la hâte.
Aristote (Éthique de Nicomaque) : Une mauvaise
loi est celle qui est faite à la hâte.
![]() Le Bon (Psychologie des foules) : Les lois qui
ont pour auteur un homme spécial, un individu qui les a préparées dans le silence du cabinet … sont naturellement les meilleures. Elles ne deviennent
désastreuses que lorsqu’une série d’amendements malheureux les rendent collectives. L’œuvre d’une foule est partout et toujours inférieure à celle d’un
individu isolé. Ce sont les spécialistes qui sauvent les assemblées des mesures trop désordonnées et trop inexpérimentées.
Le Bon (Psychologie des foules) : Les lois qui
ont pour auteur un homme spécial, un individu qui les a préparées dans le silence du cabinet … sont naturellement les meilleures. Elles ne deviennent
désastreuses que lorsqu’une série d’amendements malheureux les rendent collectives. L’œuvre d’une foule est partout et toujours inférieure à celle d’un
individu isolé. Ce sont les spécialistes qui sauvent les assemblées des mesures trop désordonnées et trop inexpérimentées.
![]() Sumner Maine (Études sur l’histoire du droit), parlant des
amendements qui touchent un texte préparé par un spécialiste : Ces interpolations ressemblent aux touches d’un artiste inférieur sur la peinture
d’un maître.
Sumner Maine (Études sur l’histoire du droit), parlant des
amendements qui touchent un texte préparé par un spécialiste : Ces interpolations ressemblent aux touches d’un artiste inférieur sur la peinture
d’un maître.
![]() Bluntschli (Droit public général) : Les commissions
peuvent sans inconvénient user largement du droit d’amendement. Il en est autrement des Chambres dans leur délibération principale ; les amendements
peuvent amener ici des erreurs et des surprises, rompre l’harmonie de la loi, en faire même oublier l’objet.
Bluntschli (Droit public général) : Les commissions
peuvent sans inconvénient user largement du droit d’amendement. Il en est autrement des Chambres dans leur délibération principale ; les amendements
peuvent amener ici des erreurs et des surprises, rompre l’harmonie de la loi, en faire même oublier l’objet.
AMIANTE - Voir : Choses suspectes ou dangereuses*.
AMICUS CURIAE
Rapprocher : Expert*.
L’amicus curiae est une personne particulièrement compétente dans un domaine donné, qu’un tribunal décide d’entendre à fin d’information. Son intervention est prévue par le Code de procédure civile, mais ne l’est pas par le Code de procédure pénale. Un tribunal répressif n’en pourrait pas moins se faire ainsi éclairer, sous réserve de respecter les droits de la défense, donc en permettant au prévenu de poser les questions qui lui semblent opportunes.
![]() Laurin (Gaz.Pal. 29 mai 2008), Les 20 ans de l'amicus curiae :
L'amicus curiae, l'ami de la Cour, a été introduit à partir d'une résolution du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ... Il s'agit de
recueillir, sur des questions complexes de fait et de droit, l'avis de personnalités qui sont entendues de manière contradictoire par le juge.
Laurin (Gaz.Pal. 29 mai 2008), Les 20 ans de l'amicus curiae :
L'amicus curiae, l'ami de la Cour, a été introduit à partir d'une résolution du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ... Il s'agit de
recueillir, sur des questions complexes de fait et de droit, l'avis de personnalités qui sont entendues de manière contradictoire par le juge.
![]() Paris 6 juillet 1988 (Gaz.Pal. 1988 II 700) :
L’amicus curiae n’est ni un témoin, ni un expert.
Paris 6 juillet 1988 (Gaz.Pal. 1988 II 700) :
L’amicus curiae n’est ni un témoin, ni un expert.
![]() Cons.
d'État 6 mai 2015 (Gaz.Pal. 28 mai 2015) :
La demande, formulée auprès d'une personne dont la
juridiction estime que la compétence ou les connaissances
seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à
donner au litige, ne peut porter que sur des observations
d'ordre général sur les points qu'elle détermine, lesquels
peuvent être des questions de droit, à l'exclusion et toute
analyse ou appréciation des pièces du dossier.
Cons.
d'État 6 mai 2015 (Gaz.Pal. 28 mai 2015) :
La demande, formulée auprès d'une personne dont la
juridiction estime que la compétence ou les connaissances
seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à
donner au litige, ne peut porter que sur des observations
d'ordre général sur les points qu'elle détermine, lesquels
peuvent être des questions de droit, à l'exclusion et toute
analyse ou appréciation des pièces du dossier.
![]() Paris 21 juin 1988 (Gaz.Pal. 1988 II 699, note Y.
Laurin) : La Cour prie le Bâtonnier en exercice de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris, de se présenter à son audience, en Chambre du
Conseil, le mercredi 29 juin 1988 à 14 heures, pour qu’en sa qualité
d' « amicus curiae », il puisse fournir, en présence de toutes les parties intéressées,
toutes observations propres à éclairer les juges dans leur recherche d’une solution au litige.
Paris 21 juin 1988 (Gaz.Pal. 1988 II 699, note Y.
Laurin) : La Cour prie le Bâtonnier en exercice de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris, de se présenter à son audience, en Chambre du
Conseil, le mercredi 29 juin 1988 à 14 heures, pour qu’en sa qualité
d' « amicus curiae », il puisse fournir, en présence de toutes les parties intéressées,
toutes observations propres à éclairer les juges dans leur recherche d’une solution au litige.
![]() Paris (1re Ch.) 16 octobre 1992 (D., 1993, jur. p.
172, note Y. Laurin), statuant dans une affaire de sang contaminé par le virus du sida : Il appartient à la Cour de s’informer sur l’époque de
l’apparition du virus, sur son évolution, sur le temps qui est susceptible de s’écouler entre la contamination et la déclaration de la maladie ainsi que
sur tous autres éléments et la Cour invite à cette fin un médecin de la recherche sur le sida, en sa qualité d’amicus curiae, à se présenter devant
elle.
Paris (1re Ch.) 16 octobre 1992 (D., 1993, jur. p.
172, note Y. Laurin), statuant dans une affaire de sang contaminé par le virus du sida : Il appartient à la Cour de s’informer sur l’époque de
l’apparition du virus, sur son évolution, sur le temps qui est susceptible de s’écouler entre la contamination et la déclaration de la maladie ainsi que
sur tous autres éléments et la Cour invite à cette fin un médecin de la recherche sur le sida, en sa qualité d’amicus curiae, à se présenter devant
elle.
AMNISTIE
Cf. Amnistie (Rappel de condamnation amnistiée)*, Clémence*, Grâce (Grâce amnistiante)*, Énerver (la répression)*, Peines*, Prescription*, Réhabilitation*.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents »
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents »
- l'amnistie est fréquemment refusée aux auteurs d'infractions
contre les mineurs : n° 403, p.233
- Notion. L’amnistie consiste en l’oubli officiel du caractère délictueux de certains agissements qui tombent sous le coup de la loi pénale, ou qui ont même déjà donné lieu à une condamnation pénale.
![]() Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) :
L’amnistie est une espèce d’oubli et même de pardon qu’un Prince accorde à ses peuples… ordinairement après une révolte ou un soulèvement.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) :
L’amnistie est une espèce d’oubli et même de pardon qu’un Prince accorde à ses peuples… ordinairement après une révolte ou un soulèvement.
L’auteur rappelle ce point d’histoire : Lorsque les Trente tyrans furent chassés d’Athènes, Trasibule fit une loi, agréée par les
Athéniens, qui
portait que de part et d’autre on oublierait ce qui s’était passé pendant la guerre ; c’est à cette époque que l’on a commencé à employer le mot
« amnistie ».
![]() Merle et Vitu (Traité de droit criminel
T.II) : L’amnistie
est la forme la plus ancienne du pardon pénal. Par une disposition générale et impersonnelle, le pouvoir décide de faire sombrer dans l’oubli certains
faits délictueux actuellement poursuivis ou à poursuivre, ou certaines condamnations déjà prononcées. Les faits ne sont pas supprimés en tant que tels,
mais leurs conséquences pénales disparaissent.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel
T.II) : L’amnistie
est la forme la plus ancienne du pardon pénal. Par une disposition générale et impersonnelle, le pouvoir décide de faire sombrer dans l’oubli certains
faits délictueux actuellement poursuivis ou à poursuivre, ou certaines condamnations déjà prononcées. Les faits ne sont pas supprimés en tant que tels,
mais leurs conséquences pénales disparaissent.
![]() Carrara
(Cours de droit criminel) : L'amnistie appartient au pouvoir
législatif. Elle est plus générale que la grâce dans ses causes,
et plus étendue dans ses effets ; elle n'éteint pas seulement la
peine, mais elle efface le délit. Cette idée est renfermée dans
l'étymologie même du mot amnistie (oubli).
Carrara
(Cours de droit criminel) : L'amnistie appartient au pouvoir
législatif. Elle est plus générale que la grâce dans ses causes,
et plus étendue dans ses effets ; elle n'éteint pas seulement la
peine, mais elle efface le délit. Cette idée est renfermée dans
l'étymologie même du mot amnistie (oubli).
![]() Décret d’amnistie du 16 août 1859 dont bénéficièrent les
opposants à Napoléon III, notamment Victor Hugo : Amnistie pleine et entière est accordée à tous les individus qui ont été condamnés pour crimes
et délits politiques, ou qui été l’objet de mesures de sûreté générales.
Décret d’amnistie du 16 août 1859 dont bénéficièrent les
opposants à Napoléon III, notamment Victor Hugo : Amnistie pleine et entière est accordée à tous les individus qui ont été condamnés pour crimes
et délits politiques, ou qui été l’objet de mesures de sûreté générales.
- Science criminelle. L'amnistie est une mesure d'extinction des poursuites ou des peines prise par le pouvoir législatif.
![]() Voir :
A. Morin, L'amnistie selon la science criminelle
Voir :
A. Morin, L'amnistie selon la science criminelle
![]() Voir :
Roux, Notions générales sur l’amnistie.
Voir :
Roux, Notions générales sur l’amnistie.
![]() Garraud (Précis de droit criminel) : L'amnistie est un acte
de souveraineté qui a pour objet et pour résultat de mettre en oubli certaines infractions et, en conséquence, d'abolir les poursuites faites ou à faire
ou les condamnations prononcées à raison de ces infractions. L'amnistie intervient donc, soit avant, soit après la condamnation ; mais, dans les deux
cas, elle efface tout ce qui s'est passé avant elle, elle supprime l'infraction, la poursuite, le jugement, tout ce qui peut être détruit, et ne s'arrête
que devant l'impossibilité du fait.
Garraud (Précis de droit criminel) : L'amnistie est un acte
de souveraineté qui a pour objet et pour résultat de mettre en oubli certaines infractions et, en conséquence, d'abolir les poursuites faites ou à faire
ou les condamnations prononcées à raison de ces infractions. L'amnistie intervient donc, soit avant, soit après la condamnation ; mais, dans les deux
cas, elle efface tout ce qui s'est passé avant elle, elle supprime l'infraction, la poursuite, le jugement, tout ce qui peut être détruit, et ne s'arrête
que devant l'impossibilité du fait.
![]() Code pénal d'Andorre. Art. 28 : La mort,
l'exécution de la condamnation, l'amnistie ou la grâce ainsi que la prescription de l'infraction éteignent la responsabilité pénale.
Code pénal d'Andorre. Art. 28 : La mort,
l'exécution de la condamnation, l'amnistie ou la grâce ainsi que la prescription de l'infraction éteignent la responsabilité pénale.
L’amnistie peut être motivée par les raisons les plus diverses. En règle générale, il s'agit pour le législateur d'apaiser le climat social ; mais une loi d'amnistie peut avoir des raisons plus prosaïques.
![]() Constant (Traité élémentaire de droit pénal belge) :
L'amnistie est un acte de souveraineté du pouvoir législatif qui jette le voile de l'oubli sur certaines infractions.
Constant (Traité élémentaire de droit pénal belge) :
L'amnistie est un acte de souveraineté du pouvoir législatif qui jette le voile de l'oubli sur certaines infractions.
![]() St
Augustin (La Cité de Dieu) : On manqua tant de soldats que
les romains enrôlèrent des criminels contre leur amnistie, et
accordèrent la liberté à des esclaves.
St
Augustin (La Cité de Dieu) : On manqua tant de soldats que
les romains enrôlèrent des criminels contre leur amnistie, et
accordèrent la liberté à des esclaves.
Caractères. Le domaine naturel de l'amnistie couvre les infractions politiques ; mais le législateur contemporain a tendance à en faire plutôt application dans le domaine des infractions de droit commun, au détriment du principe de la certitude de la peine.
![]() Accolas (Les délits et les peines, 1887) : L’amnistie
se rapporte essentiellement aux délits politiques. Nous pouvons la définir : une mesure collective prise pour effacer la trace de discordes civiles.
La majorité estime utile d’oublier le passé ; elle proclame une amnistie.
Accolas (Les délits et les peines, 1887) : L’amnistie
se rapporte essentiellement aux délits politiques. Nous pouvons la définir : une mesure collective prise pour effacer la trace de discordes civiles.
La majorité estime utile d’oublier le passé ; elle proclame une amnistie.
![]() Du Boys (Histoire du droit criminel des peuples) : On peut
voir dans le Code Théodosien la grande amnistie proclamée par Constantin lors de la défaite de Maxence
Du Boys (Histoire du droit criminel des peuples) : On peut
voir dans le Code Théodosien la grande amnistie proclamée par Constantin lors de la défaite de Maxence
L’amnistie, qui résulte essentiellement d’une loi spéciale, est d’interprétation restrictive et revêt un caractère d’ordre public.
![]() Cass.crim. 25 mars 1980 (Bull.crim. n°100
p.234) : Les lois d’amnistie sont des lois d'exception qui doivent être interprétées dans leurs termes mêmes ; il ne saurait appartenir aux juges
d'étendre leurs dispositions à des cas qu'elles n'ont pas prévus.
Cass.crim. 25 mars 1980 (Bull.crim. n°100
p.234) : Les lois d’amnistie sont des lois d'exception qui doivent être interprétées dans leurs termes mêmes ; il ne saurait appartenir aux juges
d'étendre leurs dispositions à des cas qu'elles n'ont pas prévus.
![]() Cass.crim. 26 décembre 1962 (Bull.crim. n°386
p.792) : Les lois d’amnistie sont d’application stricte, et il n’est pas permis au juge d’étendre l’amnistie par voie d’induction ou
d’analogie.
Cass.crim. 26 décembre 1962 (Bull.crim. n°386
p.792) : Les lois d’amnistie sont d’application stricte, et il n’est pas permis au juge d’étendre l’amnistie par voie d’induction ou
d’analogie.
![]() Cass. (Ch.réun.) 12 mai 1870 (S. 1870 I 324) :
Il résulte de l’amnistie une fin de non-recevoir d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent pas renoncer.
Cass. (Ch.réun.) 12 mai 1870 (S. 1870 I 324) :
Il résulte de l’amnistie une fin de non-recevoir d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent pas renoncer.
![]() Amiens 10 octobre 1889 (Gaz.Pal. T.Q. 1887-1892 v°
Amnistie n° 7) : L'amnistie doit être appliquée d'office par les tribunaux aux infractions pénales pour lesquelles elles ont été édictées.
Amiens 10 octobre 1889 (Gaz.Pal. T.Q. 1887-1892 v°
Amnistie n° 7) : L'amnistie doit être appliquée d'office par les tribunaux aux infractions pénales pour lesquelles elles ont été édictées.
Mais une loi d'amnistie est une loi nationale, qui ne saurait s'appliquer que sur le plan national.
![]() Cass.crim. 22 mai 1963 (Bull.crim. n°183
p.370) : En vertu des règles du droit public concernant la souveraineté des États, une amnistie édictée par la loi française ne saurait
s'appliquer à des décisions autres que celles émanant des juridictions françaises.
Cass.crim. 22 mai 1963 (Bull.crim. n°183
p.370) : En vertu des règles du droit public concernant la souveraineté des États, une amnistie édictée par la loi française ne saurait
s'appliquer à des décisions autres que celles émanant des juridictions françaises.
Effets. Si elle efface l’aspect pénal des faits, elle ne les justifie pas pour autant ; en sorte que les juges doivent ordonner l'indemnisation de la victime, et peuvent éventuellement prononcer des mesures de sécurité publique.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-312, p.478
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-312, p.478
![]() Garnot (Histoire
de la justice) : L'amnistie, surtout utilisée en matière
politique, au contraire de la grâce implique l'oubli d'actes
délictueux ou criminels, qui, en temps normal entraîneraient une
peine ; son effet est principalement juridique : elle n'efface
pas les faits commis mais leur ôte leur caractère délictueux, de
sorte qu'ils ne sont plus punissables, et ne constituent plus
une première infraction pour la récidive.
Garnot (Histoire
de la justice) : L'amnistie, surtout utilisée en matière
politique, au contraire de la grâce implique l'oubli d'actes
délictueux ou criminels, qui, en temps normal entraîneraient une
peine ; son effet est principalement juridique : elle n'efface
pas les faits commis mais leur ôte leur caractère délictueux, de
sorte qu'ils ne sont plus punissables, et ne constituent plus
une première infraction pour la récidive.
![]() Code pénal roumain de 1968. Art. 119 a.1 :
L’amnistie écarte la responsabilité pénale pour le fait commis.
Code pénal roumain de 1968. Art. 119 a.1 :
L’amnistie écarte la responsabilité pénale pour le fait commis.
Al. 2 : L’amnistie n’a d’effet ni sur les mesures de sûreté, ni sur les mesures éducatives, ni sur le droit à réparation de la personne lésée.
![]() Code chinois des Ta-ts’ing (par Boulais) : Si
une amnistie vient à être promulguée, on pardonnera et on oubliera les précédentes rapines des malfaiteurs ; on omettra d’en compter le nombre et de
marquer les coupables, de sorte que s’ils commettent un nouveau vol, ce vol sera regardé comme le premier par eux commis.
Code chinois des Ta-ts’ing (par Boulais) : Si
une amnistie vient à être promulguée, on pardonnera et on oubliera les précédentes rapines des malfaiteurs ; on omettra d’en compter le nombre et de
marquer les coupables, de sorte que s’ils commettent un nouveau vol, ce vol sera regardé comme le premier par eux commis.
![]() Cass.crim. 6 décembre 1988 (Gaz.Pal. 1989 I somm.
180) : Des faits de diffamation et d'injures non publiques commis antérieurement au 22 mai 1988 entrent dans les prévisions de l'art. 1er de la
loi du 20 juillet 1988 et l'action publique s'est donc trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la promulgation de ce texte ; mais la juridiction de
jugement saisie de l'action publique reste compétente en application de l'art. 24 de la loi pour statuer sur les intérêts civils.
Cass.crim. 6 décembre 1988 (Gaz.Pal. 1989 I somm.
180) : Des faits de diffamation et d'injures non publiques commis antérieurement au 22 mai 1988 entrent dans les prévisions de l'art. 1er de la
loi du 20 juillet 1988 et l'action publique s'est donc trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la promulgation de ce texte ; mais la juridiction de
jugement saisie de l'action publique reste compétente en application de l'art. 24 de la loi pour statuer sur les intérêts civils.
Danger. L'amnistie se voit reprocher un affaiblissement de l'effet préventif de la sanction pénale.
![]() Tarde (La philosophie pénale) : Il faudrait remédier à
l'abus des recours en cassation pour vices de formes et à l'abus non moindre des grâces et des amnisties, « ces jubilés du délit ».
Tarde (La philosophie pénale) : Il faudrait remédier à
l'abus des recours en cassation pour vices de formes et à l'abus non moindre des grâces et des amnisties, « ces jubilés du délit ».
![]() Garofalo (La criminologie) : L'adoucissement des peines dans
la durée est une erreur, parce qu'une plus courte incarcération pour les délinquants habituels, se traduit par un plus grand nombre de délits. On en a
fait l'expérience, en Italie après l'amnistie de 1878 qui réduisait de six mois toutes les peines, et pardonnait celles d'une durée inférieure. La
recrudescence de la criminalité fut alors très sensible dans toute t'Italie, comme on le voit par la statistique de l'année suivante.
Garofalo (La criminologie) : L'adoucissement des peines dans
la durée est une erreur, parce qu'une plus courte incarcération pour les délinquants habituels, se traduit par un plus grand nombre de délits. On en a
fait l'expérience, en Italie après l'amnistie de 1878 qui réduisait de six mois toutes les peines, et pardonnait celles d'une durée inférieure. La
recrudescence de la criminalité fut alors très sensible dans toute t'Italie, comme on le voit par la statistique de l'année suivante.
- Droit positif. En droit français son régime général est déterminé par les articles 133-9 et s. C.pén. Mais chaque loi d'amnistie spéciale fixe son propre domaine et ses propres effets (p.ex., lois des 4 août 1981, 20 juillet 1988, 3 août 1995 et 6 août 2002).
![]() Voir :
Loi d’amnistie du 6 août 2002.
Voir :
Loi d’amnistie du 6 août 2002.
![]() Cass.crim. 20 novembre 2007 (Bull.crim. n° 283 p.
1165) : Dès lors que le tribunal de police, qui a ordonné une expertise pour déterminer la durée de l'incapacité de travail de la victime avant dire
droit sur l'action publique du chef de violences contraventionnelles, avait été saisi par la citation introductive d'instance avant la publication de la
loi du 6 août 2002, la cour d'appel, qui infirme le jugement d'incompétence rendu par cette juridiction, doit, quand elle constate l'amnistie de la
contravention, en application de l'art. 1er de ce texte, statuer sur les intérêts civils, conformément à l'art. 21 de ladite loi.
Cass.crim. 20 novembre 2007 (Bull.crim. n° 283 p.
1165) : Dès lors que le tribunal de police, qui a ordonné une expertise pour déterminer la durée de l'incapacité de travail de la victime avant dire
droit sur l'action publique du chef de violences contraventionnelles, avait été saisi par la citation introductive d'instance avant la publication de la
loi du 6 août 2002, la cour d'appel, qui infirme le jugement d'incompétence rendu par cette juridiction, doit, quand elle constate l'amnistie de la
contravention, en application de l'art. 1er de ce texte, statuer sur les intérêts civils, conformément à l'art. 21 de ladite loi.
![]() Cass.crim. 8 décembre 2010 (n° 10-80764, Gaz.Pal. 14
avril 2011 note Detraz) sommaire : La peine complémentaire du suivi-socio-judiciaire prononcée à titre de peine principale peut donner lieu à
amnistie.
Cass.crim. 8 décembre 2010 (n° 10-80764, Gaz.Pal. 14
avril 2011 note Detraz) sommaire : La peine complémentaire du suivi-socio-judiciaire prononcée à titre de peine principale peut donner lieu à
amnistie.
D'un point de vue procédural, l'entrée en vigueur d'une loi d'amnistie produit un "gel" de la qualification retenue dans les poursuites en cours. Il est dès lors interdit de reprendre ces poursuites sous une nouvelle qualification.
![]() Cass.crim. 20 mai 1976 (Gaz.Pal. 1976 II 545) :
L’amnistie arrête les poursuites à partir du jour de la promulgation de la loi qui l’accorde et s’oppose à ce que les faits amnistiés reçoivent une
qualification autre que celle qui avait été antérieurement donnée par l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi.
Cass.crim. 20 mai 1976 (Gaz.Pal. 1976 II 545) :
L’amnistie arrête les poursuites à partir du jour de la promulgation de la loi qui l’accorde et s’oppose à ce que les faits amnistiés reçoivent une
qualification autre que celle qui avait été antérieurement donnée par l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi.
AMNISTIE (Rappel d'une condamnation amnistiée)
Cf. Amnistie*, Considération*, Diffamation*, Honneur*.
![]() Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.),
n° II-340, p.418
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.),
n° II-340, p.418
L'art. 133-11 du Code pénal français interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par une loi d'amnistie d'en rapporter l'existence sous quelque forme que ce soit, ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Cette disposition, assortie de sanctions pénales par certaines lois, a été prise en application d'un prétendu "droit à l'oubli", mais en méconnaissance des nécessités de la protection de la société et des personnes ; elle doit dès lors faire l'objet d'une interprétation particulièrement stricte.
![]() Maurice
Garçon, dans son ouvrage portant sur l'histoire judiciaire de la
Troisième république, rappelle l'anecdote suivante : On vit un
jour siéger à la Cour d'assises de la Seine un juré qui,
quelques années auparavant, y avait comparu pour un vol qualifié
et avait été condamné ; une bienveillante amnistie lui avait
permis, dans la même salle, de passer du banc des accusés au
banc des juges, ce qui était véritablement inadmissible et
insolent !
Maurice
Garçon, dans son ouvrage portant sur l'histoire judiciaire de la
Troisième république, rappelle l'anecdote suivante : On vit un
jour siéger à la Cour d'assises de la Seine un juré qui,
quelques années auparavant, y avait comparu pour un vol qualifié
et avait été condamné ; une bienveillante amnistie lui avait
permis, dans la même salle, de passer du banc des accusés au
banc des juges, ce qui était véritablement inadmissible et
insolent !
![]() Merle
et Vitu (Traité de droit criminel T.II) : Aux termes de
toutes les lois modernes d'amnistie, l'oubli est poussé fort
loin, puisqu'il interdit à toute personne (magistrat,
fonctionnaire, et même tout particulier) de rappeler ou de
laisser subsister dans un dossier ou autre document quelconque
les condamnations effacées par l'amnistie... Cette disposition
est inconciliable avec une bonne administration de la justice
criminelle, qui exige que les juges soient informés aussi
exactement que possible sur les antécédents des justiciables.
Merle
et Vitu (Traité de droit criminel T.II) : Aux termes de
toutes les lois modernes d'amnistie, l'oubli est poussé fort
loin, puisqu'il interdit à toute personne (magistrat,
fonctionnaire, et même tout particulier) de rappeler ou de
laisser subsister dans un dossier ou autre document quelconque
les condamnations effacées par l'amnistie... Cette disposition
est inconciliable avec une bonne administration de la justice
criminelle, qui exige que les juges soient informés aussi
exactement que possible sur les antécédents des justiciables.
![]() Cass.crim.
24 novembre 1982 (Bull.crim. n° 266 p.714) : Les dispositions
de l'art. 25 de la loi du 4 août 1981, si elles interdisent le
rappel d'une condamnation amnistiée et sanctionnent d'une amende
toute référence qui y serait faite, ne sont pas prescrites à
peine de nullité de l'acte contenant la mention prohibée ou de
la procédure au cours de laquelle le rappel aurait eu lieu.
Cass.crim.
24 novembre 1982 (Bull.crim. n° 266 p.714) : Les dispositions
de l'art. 25 de la loi du 4 août 1981, si elles interdisent le
rappel d'une condamnation amnistiée et sanctionnent d'une amende
toute référence qui y serait faite, ne sont pas prescrites à
peine de nullité de l'acte contenant la mention prohibée ou de
la procédure au cours de laquelle le rappel aurait eu lieu.
![]() Cass.crim.
12 mars 1985 (Gaz.Pal. 1985 II 644 et la note) : Si les
dispositions de l'art. 25 de la loi du 4 août 1981 qui
interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée ne prévoient
pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée, cette
nullité peut cependant être prononcée lorsqu'il résulte des
motifs d'une décision que la prise en considération de la
condamnation amnistiée a influé sur l'appréciation de la peine
sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie.
Cass.crim.
12 mars 1985 (Gaz.Pal. 1985 II 644 et la note) : Si les
dispositions de l'art. 25 de la loi du 4 août 1981 qui
interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée ne prévoient
pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée, cette
nullité peut cependant être prononcée lorsqu'il résulte des
motifs d'une décision que la prise en considération de la
condamnation amnistiée a influé sur l'appréciation de la peine
sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie.
Lorsque le rappel de faits amnistiés est incriminé par une loi d'amnistie, ce délit entre dans la famille des incriminations protégeant l'honneur et la réputation des personnes.
![]() Cass.crim.
22 mai 2012, n°11-84790 (Gaz.Pal. 2 août 2012) : Le délit de
rappel d'une condamnation amnistiée, prévu par l'art. 15 al. 3
de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, est
constitué sans qu'il soit exigé que la connaissance par le
prévenu de l'amnistie de ladite infraction soit établie.
[l'ignorance de la survenance d'une loi d'amnistie constitue une
erreur de droit inopérante, toute loi régulièrement diffusée
étant réputée connue].
Cass.crim.
22 mai 2012, n°11-84790 (Gaz.Pal. 2 août 2012) : Le délit de
rappel d'une condamnation amnistiée, prévu par l'art. 15 al. 3
de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, est
constitué sans qu'il soit exigé que la connaissance par le
prévenu de l'amnistie de ladite infraction soit établie.
[l'ignorance de la survenance d'une loi d'amnistie constitue une
erreur de droit inopérante, toute loi régulièrement diffusée
étant réputée connue].
![]() Rennes 17
janvier 1984 (JCP 1985 II 20370) : L'infraction à l'art. 25
de la loi du 4 août 1981 s'analyse comme une atteinte à la vie
privée ;
Rennes 17
janvier 1984 (JCP 1985 II 20370) : L'infraction à l'art. 25
de la loi du 4 août 1981 s'analyse comme une atteinte à la vie
privée ;
Il résulte du simple fait de la publication dans un hebdomadaire
et sans qu'il y ait besoin d'une intention coupable spéciale,
d'un rappel sous quelque forme que ce soit d'une condamnation
pénale amnistiée ;
le directeur de la publication est l'auteur principal de
l'infraction et l'auteur de l'article litigieux est complice.
Exceptionnellement, le délit peut être couvert par un fait justificatif.
![]() Cass.crim. 19 juin 2007 (Bull.crim. n° 163 p.697) :
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu des poursuites exercées contre lui du chef de rappel de sanctions disciplinaires
amnistiées, retient que leur évocation était inhérente à la nature du litige opposant les parties, dès lors que l'interdiction du rappel de sanctions
amnistiées ne peut faire obstacle, pour les tiers, à l'exercice normal des droits de la défense.
Cass.crim. 19 juin 2007 (Bull.crim. n° 163 p.697) :
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu des poursuites exercées contre lui du chef de rappel de sanctions disciplinaires
amnistiées, retient que leur évocation était inhérente à la nature du litige opposant les parties, dès lors que l'interdiction du rappel de sanctions
amnistiées ne peut faire obstacle, pour les tiers, à l'exercice normal des droits de la défense.
![]() Cass.crim. 19 juin 2007 (Gaz.Pal.
2007 somm. 3314) : Cette infraction n'est pas caractérisée si
cette mention est nécessaire à l'exercice des droits de la
défense.
Cass.crim. 19 juin 2007 (Gaz.Pal.
2007 somm. 3314) : Cette infraction n'est pas caractérisée si
cette mention est nécessaire à l'exercice des droits de la
défense.
Or, à ce titre, le prévenu estimait que ce rappel était
nécessaire pour éclairer les juges sur le contexte du litige
existant et justifié par l'exercice des droits de la défense.
La Cour d'appel considère que le rappel de la sanction n'était
pas justifié par l'exercice des droits de la défense de son
auteur, puisqu'il tendait seulement à illustrer le caractère
procédurier de la plaignante au soutien d'une demande en
paiement de 200 €. Cette décision est justifiée dans la mesure
où le rappel de la sanction amnistiée n'était pas nécessaire à
l'exercice des droits de la défense.
AMOUR
Cf. Crime passionnel*, Euthanasie*, Haine*, Jalousie*, Vertu* .
- Notion. L'amour au sens strict est d'ordinaire défini comme une disposition d'esprit qui pousse à s'attacher ardemment à une personne en souhaitant son bien. Au sens large, faisant image, on parle également de l'amour d'une valeur, notamment de l'amour de la vérité.
![]() Dictionnaire
Larousse des synonymes : Amour se dit du sentiment passionné
qui porte un sexe vers l'autre et que guide le cœur.
Dictionnaire
Larousse des synonymes : Amour se dit du sentiment passionné
qui porte un sexe vers l'autre et que guide le cœur.
![]() Cuvillier (Cours
de philosophie) : Ou bien l'amour s'adresse directement à une
valeur elle-même : c'est en ce sens que l'on parle de l'amour de
Dieu, de l'amour de la Patrie... Ou bien l'amour s'adresse, en
tant que sentiment vivant et agissant, à d'autres individus :
tel est l'amour paternel, maternel, fraternel, conjugal...
Cuvillier (Cours
de philosophie) : Ou bien l'amour s'adresse directement à une
valeur elle-même : c'est en ce sens que l'on parle de l'amour de
Dieu, de l'amour de la Patrie... Ou bien l'amour s'adresse, en
tant que sentiment vivant et agissant, à d'autres individus :
tel est l'amour paternel, maternel, fraternel, conjugal...
![]() Claproth
(Principes du droit naturel) : La principale utilité de
l'amour que la nature a inspiré aux deux sexes est sans
contredit la propagation de l'espèce humaine.
Claproth
(Principes du droit naturel) : La principale utilité de
l'amour que la nature a inspiré aux deux sexes est sans
contredit la propagation de l'espèce humaine.
- Règle morale. Pour les moralistes l'amour est une élan qui incite à faire du bien à son prochain, un sentiment qui pousse à manifester son affection envers autrui. Aussi le tiennent-ils en haute estime.
![]() Ovide (Les métamorphoses) : Pendant l'âge
d’or* les hommes vivaient dans l’amour du vrai, du bien et du beau ; alors nulle impureté, nulle incivilité, nul crime
n’était à déplorer.
Ovide (Les métamorphoses) : Pendant l'âge
d’or* les hommes vivaient dans l’amour du vrai, du bien et du beau ; alors nulle impureté, nulle incivilité, nul crime
n’était à déplorer.
![]() Aristote
(Éthique à Nicomaque) : Les hommes courageux agissent pour
l’amour du bien.
Aristote
(Éthique à Nicomaque) : Les hommes courageux agissent pour
l’amour du bien.
![]() St Paul (Lettre aux Corinthiens) : L'amour prend
patience ; l'amour rend service ; l'amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d 'orgueil ; il ne fait rien de malhonnête ;
il ne cherche pas son intérêt ; il ne s'emporte pas ; il n'entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
St Paul (Lettre aux Corinthiens) : L'amour prend
patience ; l'amour rend service ; l'amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d 'orgueil ; il ne fait rien de malhonnête ;
il ne cherche pas son intérêt ; il ne s'emporte pas ; il n'entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
![]() Jean
XXIII, dans son Encyclique Pacem in terris invite à
Vivre ensemble dans la vérité, la justice, l’amour, la
liberté.
Jean
XXIII, dans son Encyclique Pacem in terris invite à
Vivre ensemble dans la vérité, la justice, l’amour, la
liberté.
![]() Jean-Paul
II, dans son Encyclique Evangelium vitae parle d'une
« civilisation de l'amour et de la vie ».
Jean-Paul
II, dans son Encyclique Evangelium vitae parle d'une
« civilisation de l'amour et de la vie ».
![]() John
Rawls (Théorie de la justice, n° 30) : L'amour de l'humanité
se manifeste par une plus grande intensité, par l'étendue du
désir de justice et par la volonté de remplir tous les devoirs
naturels, et d'aller même au-delà de ses exigences. L'amour de
l'humanité est plus complet que le sens de la justice.
John
Rawls (Théorie de la justice, n° 30) : L'amour de l'humanité
se manifeste par une plus grande intensité, par l'étendue du
désir de justice et par la volonté de remplir tous les devoirs
naturels, et d'aller même au-delà de ses exigences. L'amour de
l'humanité est plus complet que le sens de la justice.
![]() Bentham (Déontologie
ou science de la morale) : Dans la société constituée comme
elle l'est, avec ses erreurs et ses préjugés, ses intérêts
étroits et ses passions intéressées, l'amour de la vérité impose
assez de devoirs à la vertu courageuse ; car celui qui s'avance
d'un pas au-delà du cercle tracé par nos misérables conventions
sociales autour des questions morales et politiques, celui-là
doit s'attendre à voir fulminer contre lui leurs censures et
leurs anathèmes.
Bentham (Déontologie
ou science de la morale) : Dans la société constituée comme
elle l'est, avec ses erreurs et ses préjugés, ses intérêts
étroits et ses passions intéressées, l'amour de la vérité impose
assez de devoirs à la vertu courageuse ; car celui qui s'avance
d'un pas au-delà du cercle tracé par nos misérables conventions
sociales autour des questions morales et politiques, celui-là
doit s'attendre à voir fulminer contre lui leurs censures et
leurs anathèmes.
- Science criminelle. Il semble dès lors qu'il n'y ait rien de plus étranger au droit pénal que l'amour. Pourtant ce sentiment peut se muer en haine, se dévoyer, et éventuellement conduire à perpétrer des actes dangereux pour l'ordre social.
![]() Confucius
(La Grande étude) se situant au niveau de la Nation : Yao et
Chun gouvernèrent l'empire avec l'amour de l'humanité, et le
peuple les imita. Kie et Tchèou gouvernèrent l'empire avec
cruauté, et le peuple les imita. C'est pourquoi le prince doit
(lui-même) pratiquer la vertu, et ensuite inviter les autres
hommes à l'imiter.
Confucius
(La Grande étude) se situant au niveau de la Nation : Yao et
Chun gouvernèrent l'empire avec l'amour de l'humanité, et le
peuple les imita. Kie et Tchèou gouvernèrent l'empire avec
cruauté, et le peuple les imita. C'est pourquoi le prince doit
(lui-même) pratiquer la vertu, et ensuite inviter les autres
hommes à l'imiter.
C'est au nom de l'amour que d'aucuns ont voulu faire un sort particulier au Crime passionnel*. C'est aussi en considération pour l'amour et la pitié que certains entendent justifier l'Euthanasie* ; alors que si ces sentiments peuvent constituer une circonstance atténuante personnelle, ils ne sauraient faire disparaître l'intention d'ôter la vie donc le crime de meurtre.
![]() Voir :
Dr J. Maxwell, Le criminel d'occasion
Voir :
Dr J. Maxwell, Le criminel d'occasion
![]() Exemple
de délit passionnel (Ouest-France
31janvier 2014) : Hier, la directrice d'une clinique de
Roskoff comparaissait devant la Chambre de l'instruction à
Rennes. Elle a expliqué aux magistrats qu'elle a détourné
600.000 € par amour pour un brésilien rencontré en 2012. L'homme
avait besoin d'argent pour débloquer une somme en Afrique.
Exemple
de délit passionnel (Ouest-France
31janvier 2014) : Hier, la directrice d'une clinique de
Roskoff comparaissait devant la Chambre de l'instruction à
Rennes. Elle a expliqué aux magistrats qu'elle a détourné
600.000 € par amour pour un brésilien rencontré en 2012. L'homme
avait besoin d'argent pour débloquer une somme en Afrique.
![]() Code pénal du Salvador. Art. 130 : L'homicide
causé par des raisons de piété, afin d'accélérer un décès imminent ou de mettre fin à des souffrances graves, sera puni de un à cinq ans de
prison, à condition que soient réunies les conditions suivantes : 1) Que la victime se trouve dans un état de désespoir par suite de souffrances
visibles, publiquement constatées et confirmées par l'avis des médecins traitants ; 2) Que le sujet actif soit uni au patient par des liens
familiaux, d'amitié proche, ou d'amour ; 3) Qui le sujet passif ait montré son désir de mourir par des manifestations externes, par des demandes
réitérées et expresses.
Code pénal du Salvador. Art. 130 : L'homicide
causé par des raisons de piété, afin d'accélérer un décès imminent ou de mettre fin à des souffrances graves, sera puni de un à cinq ans de
prison, à condition que soient réunies les conditions suivantes : 1) Que la victime se trouve dans un état de désespoir par suite de souffrances
visibles, publiquement constatées et confirmées par l'avis des médecins traitants ; 2) Que le sujet actif soit uni au patient par des liens
familiaux, d'amitié proche, ou d'amour ; 3) Qui le sujet passif ait montré son désir de mourir par des manifestations externes, par des demandes
réitérées et expresses.
De toute manière, l'amour envers une personne ne saurait légitimer la commission d'une infraction à l'encontre d'un tiers. Il doit au contraire conduire à aider son prochain dans les cas d'urgence (d'où l'incrimination de Non-assistance à personne en danger* et celle de Refus de prêter le secours requis* par un agent public en cas de catastrophe naturelle mettant des vies en danger).
![]() Von
Liszt (Traité de droit pénal allemand) : Le paragraphe
dit d'amour est dirigé contre celui qui, en présence ou en cas
de détresse ou de sinistre publics, refuse de fournir l'aide
requise par l'autorité de police ou ses agents, bien qu'il lui
soit possible de donner suite à cette réquisition sans danger
notable pour lui-même.
Von
Liszt (Traité de droit pénal allemand) : Le paragraphe
dit d'amour est dirigé contre celui qui, en présence ou en cas
de détresse ou de sinistre publics, refuse de fournir l'aide
requise par l'autorité de police ou ses agents, bien qu'il lui
soit possible de donner suite à cette réquisition sans danger
notable pour lui-même.
![]() Constitution criminelle de Charles Quint (Caroline) : Art. 3.
Le Serment du Juge, pour prononcer sur la Mort - Je, N…., jure de rendre justice et de prononcer jugement en affaire criminelle également pour
le pauvre et pour le riche, sans avoir égard à l’amour ni à la haine ...
Constitution criminelle de Charles Quint (Caroline) : Art. 3.
Le Serment du Juge, pour prononcer sur la Mort - Je, N…., jure de rendre justice et de prononcer jugement en affaire criminelle également pour
le pauvre et pour le riche, sans avoir égard à l’amour ni à la haine ...
AMPUTATION - Voir : Mutilation (sanction)*.